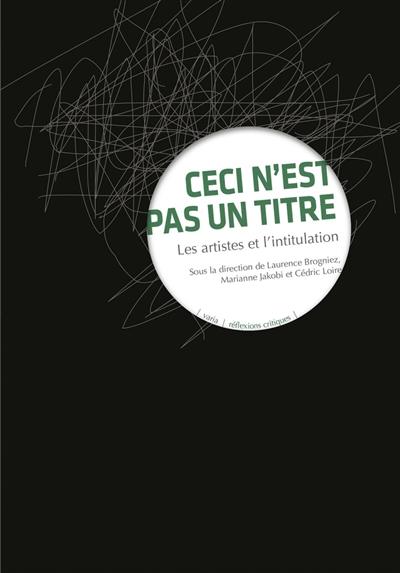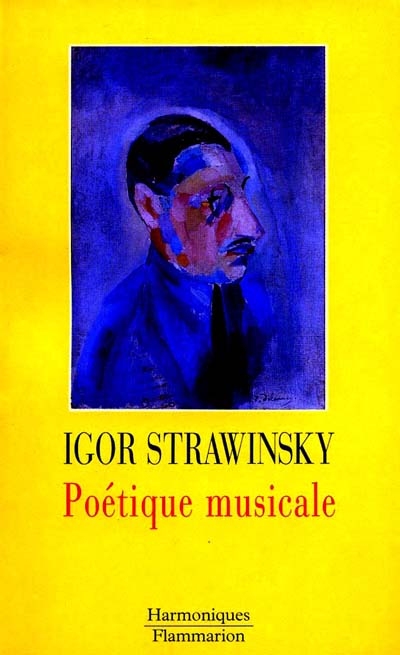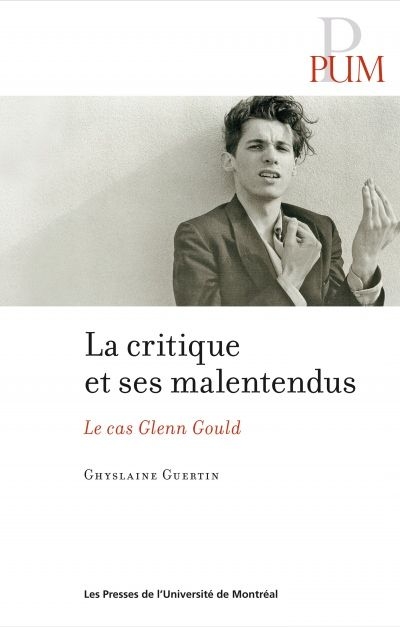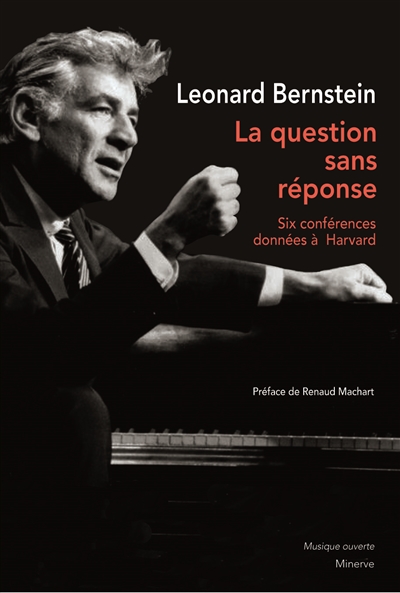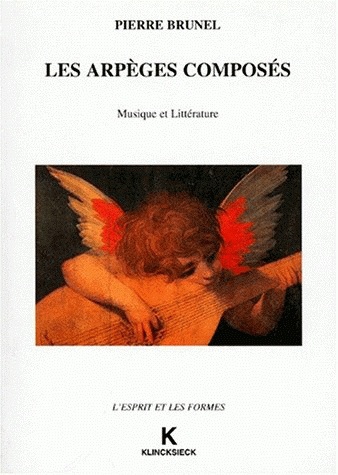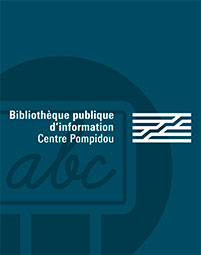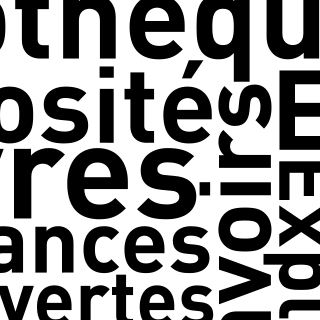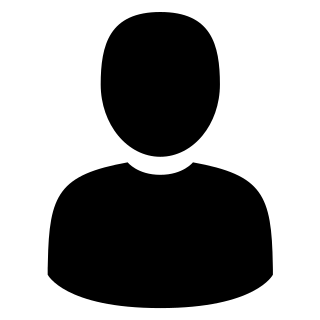Fage éd.
2014 -
-
Disponible - 7.01 BRO
Etage 2 - Arts - Arts
Résumé : Cet ouvrage réunit une vingtaine de contributions consacrées aux enjeux et aux modalités de l'intitulation. Les influences et les interférences qui s'opèrent entre différents domaines de la création (beaux-arts, musique, poésie) sont abordées dans une perspective comparatiste. ©Electre 2015

 Les bibliothèques de la ville de Paris
Les bibliothèques de la ville de Paris
 Les bibliothèques universitaires
Les bibliothèques universitaires
 La BnF
La BnF
 L'encyclopédie Wikipédia
L'encyclopédie Wikipédia
 L'Encyclopædia Universalis
L'Encyclopædia Universalis
 La bibliothèque du film
La bibliothèque du film
 La médiathèque de la Philharmonie de Paris
La médiathèque de la Philharmonie de Paris