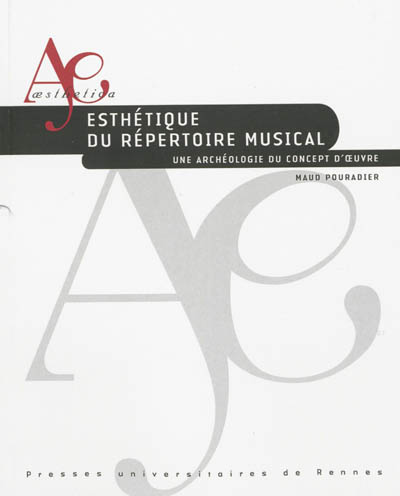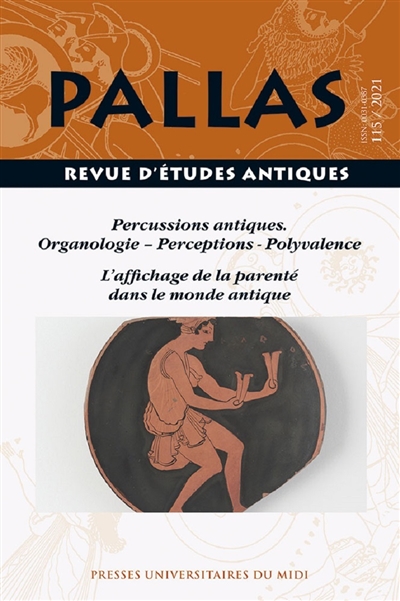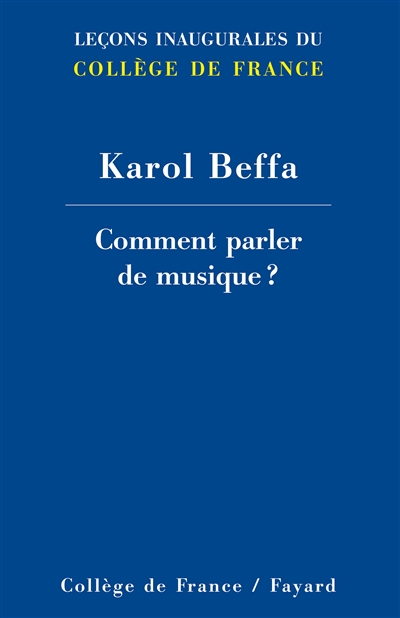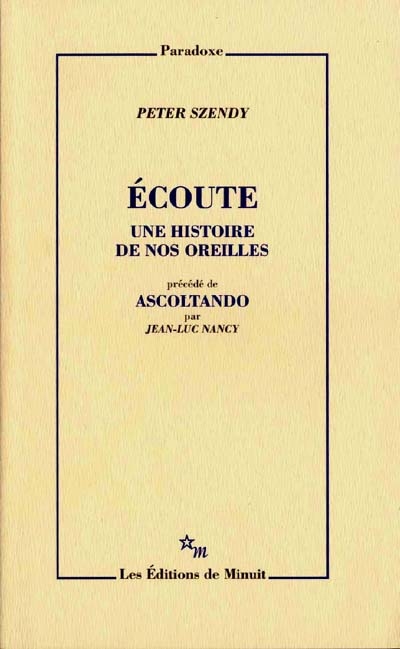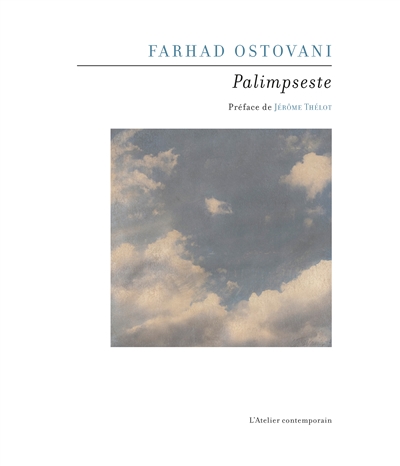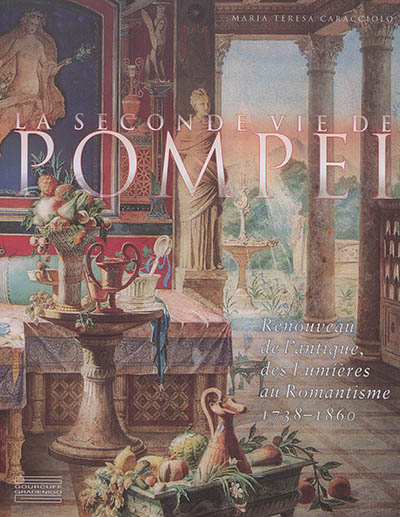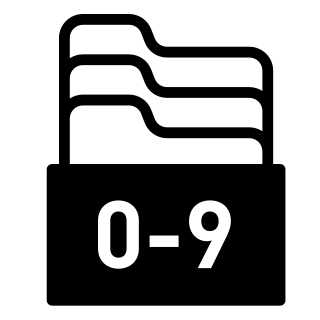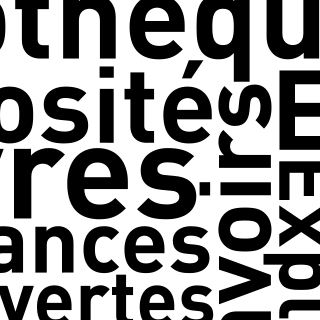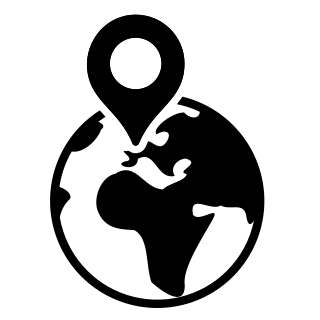par Pouradier, Maud (1981-....)
Presses universitaires de Rennes
2013 -
-
Disponible - 780 POU
Etage 2 - Musique - Musiques et documents parlés
Résumé : L'auteure propose une réflexion philosophique sur le concept d'oeuvre musicale tout en s'interrogeant sur l'existence du répertoire en musique, notion omniprésente dans les discours des musiciens depuis la seconde moitié du XVIIIe siècle, mais ignoré des philosophes et des esthéticiens. L'intérêt est de découvrir comment le répertoire modifie la perception et la conception de la musique.

 Les bibliothèques de la ville de Paris
Les bibliothèques de la ville de Paris
 Les bibliothèques universitaires
Les bibliothèques universitaires
 La BnF
La BnF
 L'encyclopédie Wikipédia
L'encyclopédie Wikipédia
 L'Encyclopædia Universalis
L'Encyclopædia Universalis
 La bibliothèque du film
La bibliothèque du film
 La médiathèque de la Philharmonie de Paris
La médiathèque de la Philharmonie de Paris