
Relations internationales : Une perspective européenne
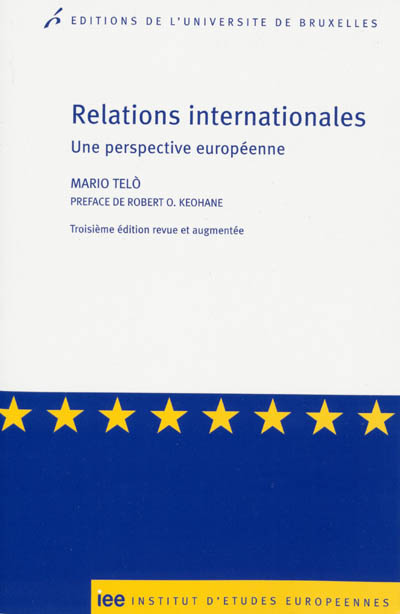
- Éditeur(s)
-
Date
- 2019
-
Notes
- Découvrez la complexité et les enjeux des relations internationales à l'heure de la globalisation. Nourri d’une connaissance approfondie des théories développées de part et d’autre de l’Atlantique et d’une expérience internationale affinée par la participation de son auteur à l’agenda scientifique européen, cet ouvrage retrace les origines d’une discipline académique devenue autonome au début du XXe siècle et brosse un panorama critique des divergences et des complémentarités des écoles de pensée qui ont animé le débat théorique ces dernières décennies. Cette étude critique parcoure, d'un point de vue européen, les différentes écoles de pensée qui ont participé et participent à l'élaboration des relations internationales. EXTRAIT Nous l’avons évoqué, cette expérience n’est pas isolée dans le monde globalisé du XXIe siècle. Nonobstant les obstacles multiples, des tendances parallèles – différentes mais similaires – se développent sur chaque continent, des Amériques à l’Asie, de l’Afrique à l’Océanie, vers la coopération régionale et globale, vers une autolimitation de la souveraineté par la coopération entre des Etats voisins : malgré l’hétérogénéité du système global de transition de l’après-guerre froide, de nouvelles formes de gouvernance régionale et globale sont en train d’émerger, des voies originales vers la transformation de l’Etat, de la gouvernance globale et du système mondial, dans le sens de l’institutionnalisation, de la souveraineté partagée, d’un nouvel équilibre entre autonomie des organisations internationales et légitimité. Nous prônons donc dans ce livre un enrichissement réciproque et mutuel entre les Etudes européennes et les théories des Relations internationales.
-
Langues
- Français
-
ISBN
- 9782800415482
-
Droits
- copyrighted
- Résultat de :
-
Quatrième de couverture
-
Relations internationales
Une perspective européenne
Nourri d'une connaissance approfondie des théories développées de part et d'autre de l'Atlantique et d'une expérience internationale affinée par la participation de son auteur à l'agenda scientifique européen (et notamment aux réseaux de recherche mondiaux « Garnet », « Green » et Erasmus-Mundus doctoral « GEM »), cet ouvrage de Mario Telò, qui a été traduit aussi en anglais (2009) et en mandarin (2011), retrace les origines d'une discipline académique devenue autonome au début du XXe siècle et brosse un panorama critique des divergences et des complémentarités des écoles de pensée (réalisme, institutionnalisme, constructivisme, entre autres) qui ont animé le débat théorique ces dernières décennies et se sont efforcées de rendre compte de la complexité des relations internationales et des enjeux auxquels l'humanité est confrontée dans un monde globalisé.
L'auteur adopte aussi - et c'est là l'originalité de son livre - une perspective européenne et accorde une attention particulière à l'expérience de souveraineté autolimitée et partagée, de coopération régionale institutionnalisée, menée - depuis la « déclaration Schuman » de 1950 - par des Etats jadis belligérants, aux niveaux de la CE et de l'UE. Comme le note Robert 0. Keohane, dans la préface de l'ouvrage, ce « système politique supranational en formation » est un « laboratoire d'idées » qui « pose des défis de taille à la science politique et aux théories des Relations internationales, pour redéfinir les concepts de puissance, de souveraineté, de légitimité, de démocratie ». L'intégration régionale entre Etats et sociétés voisins est-elle un phénomène limité à un seul continent ? Ou faut-il y voir une forme de gouvernance nouvelle, le laboratoire sophistiqué d'une large tendance vers l'institutionnalisation de la vie internationale, amenant à une révision graduelle et partielle du paradigme souverainiste « westphalien », dans un monde en constante évolution ?
Et le politologue de Princeton University d'ajouter à propos de ce livre novateur : « La théorie n'est pas un objet d'art. Sinon, elle est pire qu'inutile, une distraction. Nous avons besoin du débat théorique pour comprendre les grands défis de l'humanité et ainsi aider les êtres humains à résoudre les questions touchant à leur survie ».
« Les débats théoriques en Relations internationales ont été dominés par des perspectives et préoccupations américaines. Ce livre est novateur en ce qu'il offre une perspective européenne sur ces débats. Mario Telò défend de façon convaincante la thèse selon laquelle le développement et la consolidation de l'Union européenne demandent de revoir les théories majeures des Relations internationales. Ce livre sera une référence pour tous les étudiants de politique internationale »
Andrew Gamble, directeur du département de Science politique, Université de Cambridge« Mario Telò offre simplement la meilleure présentation disponible de l'impact du projet européen sur les théories des Relations internationales. Tous les analystes ne le suivront pas lorsqu'il affirme que le succès de l'Union européenne demande un changement de paradigme théorique. Mais aucun chercheur désireux de présenter une théorie complète de la politique internationale contemporaine ne pourra éviter de se confronter avec sa thèse »
Richard Higgott, professeur de Politique internationale et vice-recteur, Université de Warwick.
-
-
Tables des matières
-
- Avant-propos à la troisième édition7
- Préface par Robert O. Keohane11
- Introduction15
- 1. Le pluralisme au niveau des théories des Relations internationales : une perspective européenne15
- 2. Les enjeux méthodologiques et épistémologiques de la discipline : un questionnement européen19
- 3. Le paradigme de Westphalie et sa révision23
- Chapitre I. - Les origines de la discipline et l'affirmation de l'Ecole réaliste27
- 1. De l'Antiquité au Moyen Age27
- 2. Thomas Hobbes, Grotius et l'Ecole dominicaine espagnole28
- 3. Les courants de la pensée européenne du XVIIe au XIXe siècle31
- A. Emmanuel Kant et les traditions pacifistes31
- B. L'Europe entre l'anarchie internationale et le processus de civilisation du système des Etats souverains : le multipolarisme et le multilatéralisme entre le XIXe et le XXe siècle34
- 4. La crise de l'entre-deux-guerres. Européanisme, nationalisme et économie politique41
- 5. L'affirmation du réalisme45
- A. Edward H. Carr45
- B. Hans Morgentau47
- C. Raymond Aron49
- D. La théorie réaliste : synthèse50
- Chapitre II. - Les approches systémiques et le néo-réalisme aux Etats-Unis53
- 1. La théorie des systèmes et les sciences sociales et politiques : D. Easton et T. Parsons54
- 2. La théorie des systèmes appliquée à la politique internationale : Morton Kaplan58
- 3. La théorie néo-réaliste de Kenneth Waltz63
- Chapitre III. - L'Economie politique internationale69
- 1. La genèse de l'Economie politique internationale69
- 2. L'approche réaliste de l'Economie politique internationale : Robert Gilpin71
- A. Guerre et changement dans la politique mondiale. Les cycles de la puissance71
- B. La théorie de la stabilité hégémonique chez Gilpin72
- C. La centralité de l'Etat adaptée à la mondialisation74
- 3. L'Economie politique internationale de Susan Strange : l'Etat, un acteur parmi d'autres sur la scène mondiale ?75
- Chapitre IV - L'influence de Karl Marx sur les théories des Relations internationales77
- 1. Gramsci et l'Ecole canadienne78
- 2. De la « théorie de la dépendance » à la théorie du « système-monde » d'Immanuel Wallerstein80
- Chapitre V. - Critique et dépassement du réalisme et du néo-réalisme89
- 1. L'approche multi-variables de Stanley Hoffmann et le rôle du droit90
- 2. Les théories de la coopération : les régimes internationaux96
- 3. Le transnationalisme et l'interdépendance complexe : Robert O. Keohane et Joseph S. Nye100
- 4. La théorie de la stabilité hégémonique et sa critique104
- Chapitre VI. - Les théories institutionnalistes107
- 1. L'« Ecole anglaise » et Hedly Bull107
- 2. Du fonctionnalisme au néo-fonctionnalisme110
- 3. Le revival néo-institutionnaliste113
- A. L'institutionnalisme rationaliste116
- B. L'institutionnalisme historique117
- C. L'institutionnalisme sociologique118
- D. L'institutionnalisme discursif119
- Chapitre VII. - Un monde post-westphalien ?123
- 1. Le concept de « global governance » et l'apport de J.N. Rosenau. « World Society » et néo-médiévalisme124
- 2. Les « théories critiques » et les « théories post-modernes » des Relations internationales127
- 3. Gender Studies et Relations internationales129
- 4. Les théories post-modernes des Relations internationales : une synthèse et un défi130
- Chapitre VIII. - Les approches constructives133
- 1. Le cadre philosophique133
- 2. La recherche de A. Wendt : structure, agent, normes135
- 3. Etudes de cas et questions ouvertes136
- Chapitre IX. - Les théories de la politique étrangère
L'impact des facteurs internes141 - 1. Théories économiques et politiques de l'impérialisme142
- 2. La théorie de l'insécurité145
- 3. Les théories du régime politique147
- A. Le régime politique démocratique et la politique étrangère149
- B. Système partisan démocratique et politique étrangère : le phénomène du « bipartisanship »150
- C. Démocratie parlementaire et démocratie présidentielle151
- D. Le « double Etat »152
- 4. Les théories du processus décisionnel152
- Chapitre X. - L'apport des études européennes au renouvellement des théories des Relations internationales157
- 1. Après le changement systémique de 1989-1991 : idéologies et théories des Relations internationales158
- 2. La question controversée du rôle des Etats-Unis dans le système international166
- 3. La Communauté européenne/UE et le réseau des organisations internationales : la relance des études institutionnalistes170
- 4. Globalisation, régionalisation, néo-régionalisme : l'institutionnalisation complexe de la vie internationale172
- 5. Le régionalisme de l'UE et le multilatéralisme180
- 6. La souveraineté en question : le système UE183
- 7. La mise en cause de la séparation entre sphères interne et externe à l'Etat187
- 8. Les notions de puissance civile et de politique étrangère structurelle dans le cadre d'un monde multipolaire189
- Conclusions197
- 1. La perspective européenne et les autres : continuité et discontinuité avec l'héritage de la discipline197
- 2. La spécificité de la contribution européenne à l'agenda de la recherche internationaliste199
- Annexe
- Les organisations multilatérales régionales, interrégionales et globales par Sebastien Santander205
- 1. Organisations et accords régionaux205
- A. Afrique205
- B. Amériques210
- C. Monde arabe et Maghreb216
- D. Asie218
- E. Europe220
- F. Océanie224
- 2. Organisations et accords intérrégionaux225
- 3. Organisations multilatérales globales230
- A. Organisation des Nations unies, 1945230
- B. Les « organisations de Bretton Woods »232
- Bibliographie235
- Table des matières243
-
-
Consultable à la Bpi

