
Droit des entreprises en difficulté
Résumé
Synthèse sur le droit des instruments de paiement et de crédit : chèques, virements, cartes pour le paiement, lettres de change, billets à ordre pour le crédit, droit des entreprises en difficulté et évolution des techniques financières. A jour des dernières évolutions jurisprudentielles intervenues dans ce domaine.
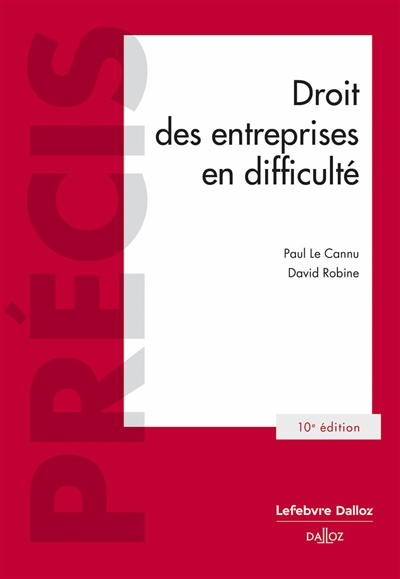
- Autre(s) auteur(s)
- Éditeur(s)
-
Date
- 2025
-
Notes
- Bibliogr. Index
-
Langues
- Français
-
Description matérielle
- 1 vol. (1000 p.) ; 22 x 15 cm
- Collections
- Sujet(s)
- Lieu
-
ISBN
- 978-2-247-23967-2
-
Quatrième de couverture
-
Droit des entreprises en difficulté
Le droit des entreprises en difficulté évolue constamment, et souvent de façon substantielle, pour toutes sortes de raisons, qu'elles soient structurelles ou conjoncturelles. Pour guider le lecteur sur cette mer agitée, un travail d'analyse de la matière et une présentation didactique sont indispensables.
Successeur du droit de la « faillite », puis du droit des « procédures collectives », le droit des « entreprises en difficulté » s'est affirmé en 1985. Il a connu depuis des innovations significatives, destinées à offrir davantage d'outils pour la restructuration et le sauvetage des entreprises, tout en facilitant les voies de la liquidation. Plus récemment, le souci d'assurer un droit au rebond du débiteur défaillant est devenu prégnant.
La matière a dû s'adapter à l'internationalisation des relations d'affaires et au nombre croissant de procédures d'insolvabilité transnationales. Plusieurs textes européens, dont le règlement n° 2015/848 du 20 mai 2015, ont été adoptés à cette fin, sans régir cependant toutes les procédures d'insolvabilité internationales.
Enfin, en interaction constante avec d'autres disciplines, le droit des entreprises en difficulté subit, par ricochet, les effets de leurs évolutions, parfois profondes. On songe notamment au droit des sûretés substantiellement réformé par l'ordonnance n° 2021-1 192 du 15 septembre 2021.
Cet ouvrage, principalement destiné aux étudiants qui découvrent la matière, cherche aussi à approfondir certains sujets épineux afin que les praticiens puissent alimenter leurs réflexions. Il intègre les dernières évolutions jurisprudentielles et législatives, telles que celles relatives aux classes de parties affectées issues de l'ordonnance n° 2021-1 193 du 15 septembre 2021.
-
-
Tables des matières
-
Droit des entreprises en difficulté 10e édition
Paul Le Cannu
David Robine
Lefebvre Dalloz
- SommaireV
- AbréviationsIX
- BibliographieXI
- Avant-propos de la 10e éditionXIII
- Introduction1
- Partie 1
- Les dispositifs de prévention et de traitement des difficultés des entreprises13
- Sous-partie 1
- Les procédés amiables15
- Titre 1
- La conscience des difficultés19
- Chapitre 1
- L'information sur la situation de l'entreprise 21
- Section 1 - L'Information comptable 21
- Section 2 - Les publicités obligatoires 23
- Chapitre 2
- L'alerte 29
- Section 1 - Le devoir d'alerte du commissaire aux comptes 30
- § 1. Le déclenchement de l'alerte33
- § 2. Le processus de l'alerte38
- A. L'alerte dans la société anonyme39
- B. L'alerte dans les autres sociétés commerciales et les groupements d'intérêt économique42
- C. L'alerte dans certaines personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique45
- Section 2 - Le droit d'alerte du comité social et économique46
- § 1. Le déclenchement de l'alerte47
- § 2. Le déroulement de l'alerte49
- Section 3 - Le droit d'alerte du président du tribunal 51
- Section 4 - L'alerte par les groupements de prévention agréés 56
- Titre 2
- Le traitement amiable des difficultes59
- Sous-titre 1
- Les aides publiques61
- Chapitre 1
- Modalites des aides publiques 63
- Chapitre 2
- Risques inhérents aux aides publiques 71
- Section 1 - Le risque de distorsion de concurrence 71
- Section 2 - Le risque de responsabilité 76
- Sous-Titre 2
- Les procédés de négociation assistée79
- Chapitre 1
- Le mandat ad hoc 83
- Section 1 - La désignation du mandataire ad hoc 83
- Section 2 - Les missions du mandataire ad hoc 90
- Chapitre 2
- La conciliation 99
- Section 1 - La mise en place de la conciliation 103
- § 1. La décision de recourir à la conciliation104
- A. L'accès à la conciliation104
- 1° Les entreprises éligibles104
- 2° Les difficultés concernées106
- 3° La liberté de recourir à la conciliation109
- B. La demande de conciliation110
- § 2. L'ouverture de la conciliation113
- A. La décision d'ouverture113
- B. La récusation du conciliateur116
- Section 2 - Le déroulement de la conciliation 117
- § 1. La structuration de la négociation118
- A. Missions et prérogatives du conciliateur118
- B. Statut du conciliateur123
- § 2. La négociation de l'accord124
- A. La négociation d'un accord efficient124
- 1° La détermination des parties à la négociation124
- 2° Le choix du contenu de l'accord129
- B. Une négociation confidentielle131
- Section 3 - Les issues de la négociation 132
- § 1. L'absence d'accord132
- § 2. La conclusion d'un accord134
- § 3. L'état des frais136
- § 4. La constatation ou l'homologation de l'accord137
- A. Les modalités d'intervention du juge137
- 1° La constatation de l'accord137
- 2° L'homologation de l'accord139
- a. La procédure d'homologation139
- b. Les conditions de fond de l'homologation142
- B. Les effets de ta constatation et de l'homologation de l'accord144
- 1° Les effets communs à la constatation et à l'homologation144
- 2° Les effets spécifiques de l'homologation147
- a. Le privilège de conciliation147
- b. Le blocage du report de la date de cessation des paiements150
- Section 4 - L'exécution de l'accord 151
- § 1. La modification de l'accord151
- § 2. Les incidents d'exécution152
- A. Résolution de l'accord pour inexécution153
- B. Caducité de l'accord en raison de l'ouverture d'une procédure collective154
- C. Clauses relatives à la caducité ou à la résolution de l'accord156
- Chapitre 3
- Le règlement amiable agricole 159
- Sous-Partie 2
- Les procédures collectives161
- Titre 1
- L'évolution du droit des procédures collectives163
- Chapitre 1
- Éléments d'histoire du droit des procédures collectives 165
- Section 1 - Dépérissement progressif du droit de la faillite 166
- § 1. Le droit de la faillite dans le Code de commerce167
- A. Le droit de la faillite dans le Code de 1807 167
- B. Les lois du 28 mai 1838 et du 4 mars 1889 167
- C. Les textes de circonstance168
- § 2. Le droit de la faillite dans le décret du 20 mai 1955 169
- Section 2 - Émergence d'un droit des entreprises en difficulté 170
- § 1. La loi du 13 juillet 1967 171
- § 2. L'ordonnance du 23 septembre 1967 172
- § 3. La loi du 25 janvier 1985 174
- A. Les raisons de la réforme de 1985 174
- B. Les finalités de la réforme de 1985 176
- C. Les retouches apportées par la loi du 10 juin 1994 181
- Chapitre 2
- Le droit positif des procédures collectives 183
- Section 1 - La loi de sauvegarde 185
- Section 2 - Les réformes de la loi de sauvegarde 187
- Titre 2
- L'entreprise au pouvoir de la procédure collective199
- Sous-Titre 1
- L'ouverture de la procédure collective201
- Chapitre 1
- Les débiteurs soumis aux procédures collectives 203
- Section 1 - L'hypothèse générale 203
- Sous-section 1 - L'entreprise 204
- § 1. L'identification de l'entreprise204
- A. Les personnes physiques204
- 1° L'entrepreneur en activité205
- a. L'activité commerciale206
- b. L'activité artisanale211
- c. L'activité agricole212
- d. Les autres activités professionnelles indépendantes215
- 2° L'entrepreneur ayant cessé son activité218
- a. La cessation volontaire218
- b. Le décès du débiteur220
- B. Les personnes morales de droit privé222
- 1° Entités visées222
- 2° Entités exclues224
- § 2. Identification du sujet de la procédure collective225
- A. La sujétion du débiteur à la procédure collective225
- B. La sujétion du patrimoine à la procédure collective228
- 1° La séparation des patrimoines229
- a. Entrepreneur individuel et procédure collective229
- 1) L'EIRL231
- 2) Le statut d'entrepreneur individuel238
- α) Principe de séparation du patrimoine personnel et du patrimoine professionnel238
- β) L'emprise de la procédure du Livre VI du Code de commerce249
- b. La-fiducie252
- 2° La délimitation du patrimoine soumis à la procédure collective253
- C. La sujétion de l'entreprise à la procédure collective254
- Sous-section 2 - Les difficultés de l'entreprise 256
- § 1. Définition et preuve de la cessation des paiements257
- A. Définition de la cessation des paiements257
- 1° Le passif exigible258
- 2° L'actif disponible260
- 3° La balance entre le passif exigible et l'actif disponible261
- 4° L'appréciation objective de la cessation des paiements263
- B. Preuve de la cessation des paiements264
- § 2. Détermination des difficultés requises266
- A. Les difficultés permettant Couverture d'une procédure de sauvegarde266
- B. Les difficultés conduisant à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde accélérée271
- C. Les difficultés conduisant à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire272
- D. Les difficultés conduisant à l'ouverture d'une procédure de traitement de sortie de crise272
- E. Les difficultés conduisant à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire273
- Section 2 - L'extension de procédure 274
- § 1. Les critères de l'extension de procédure275
- A. La fictivité de la personne morale276
- B. La confusion des patrimoines278
- § 2. Le régime de l'action en extension de procédure283
- § 3. Les effets de l'extension de procédure286
- A. Une masse patrimoniale unique286
- B. Une procédure unique288
- C. La fin des effets de l'extension de procédure290
- Chapitre 2
- Le déclenchement des procédures collectives 293
- Section 1 - Saisine en vue d'une procédure de sauvegarde 293
- Section 2 - Saisine en vue d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire 299
- § 1. La saisine par le débiteur300
- § 2. Assignation par un créancier303
- § 3. Requête du ministère public306
- § 4. Suppression de la saisine d'office du tribunal308
- Section 3 - Saisine en vue d'une procédure de traitement de sortie de crise 309
- Section 4 - Saisine en vue d'une procédure de surendettement 310
- Section 5 - Préliminaires au jugement d'ouverture 311
- Chapitre 3
- Le jugement d'ouverture 313
- Section 1 - Compétence du tribunal 313
- § 1. La compétence pour ouvrir une procédure du Livre VI du Code de commerce314
- A. La compétence d'attribution314
- B. La compétence territoriale316
- § 2. L'unité procédurale322
- § 3. La compétence pour ouvrir une procédure à l'égard du patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel325
- Section 2 - Contenu du jugement d'ouverture 325
- § 1. La détermination de la procédure ouverte326
- A. Les procédures impliquant une période d'observation327
- 1° Le déroulement de la période d'observation327
- a. La durée de la période d'observation327
- b. La gestion de l'entreprise au cours de la période d'observation330
- c. La préparation du plan331
- 2° L'issue de la période d'observation331
- a. Les issues positives332
- 1) Cessation de la sauvegarde pour disparition des difficultés332
- 2) Sortie du redressement judiciaire par retour du débiteur à la solvabilité334
- b. Les issues négatives335
- 1) La conversion en redressement judiciaire336
- 2) Le prononcé d'une liquidation judiciaire337
- B. La liquidation judiciaire immédiate338
- § 2. La désignation du juge-commissaire et des organes de la procédure339
- A. Le juge-commissaire339
- 1° Désignation et fin des fonctions du juge-commissaire339
- 2° Les fonctions du juge-commissaire341
- a. Description des fonctions341
- b. Les ordonnances du juge-commissaire343
- B. Les organes des procédures collectives345
- 1° Les professionnels des procédures collectives345
- a. Règles communes aux administrateurs et aux mandataires judiciaires346
- b. Règles propres à chaque profession349
- 1) L'administrateur judiciaire350
- 2) Le mandataire judiciaire356
- 2° Les organes non professionnels361
- a. Le représentant des salariés361
- 1) Désignation du représentant des salariés361
- 2) Statut du représentant des salariés363
- 3) Missions du représentant des salariés364
- b. Les contrôleurs364
- 1) Statut des contrôleurs366
- 2) Mission des contrôleurs368
- § 3. La fixation de la date de cessation des paiements372
- § 4. Les mesures affectant les droits des dirigeants et associés373
- Section 3 - Publicité et prise d'effet du jugement d'ouverture 374
- Section 4 - Voies de recours 376
- § 1. Les voies de recours offertes376
- A. Appel du jugement d'ouverture377
- B. Tierce-opposition formée contre le jugement d'ouverture378
- § 2. Exécution provisoire du jugement d'ouverture382
- Sous-Titre 2
- Les effets de la procédure collective385
- Chapitre 1
- Les contraintes inhérentes à la procédure collective 387
- Section 1 - Les contraintes imposées au débiteur 388
- § 1. L'encadrement des pouvoirs en période d'observation389
- A. Les pouvoirs du débiteur390
- 1° Les actes autorisés390
- 2° Les actes interdits391
- B. Les potentielles missions de l'administrateur judiciaire393
- § 2. Le dessaisissement en liquidation judiciaire398
- § 3. L'interdiction de la modification du patrimoine professionnel409
- Section 2 - Les interdictions affectant les créanciers 409
- Sous-section 1 - Les créanciers affectés 410
- § 1. La détermination des créanciers affectés410
- A. Les créanciers antérieurs411
- B. Les créanciers postérieurs non privilégiés414
- C. Règles spécifiques à la sauvegarde accélérée416
- § 2. L'organisation collective des créanciers affectés417
- A. L'organisation abandonnée : la masse des créanciers417
- B. L'organisation actuelle : la représentation des créanciers418
- Sous-section 2 - Les restrictions imposées 423
- § 1. La suspension des prérogatives ordinaires du droit de créance424
- A. L'interdiction des paiements424
- 1° Le principe426
- 2° Paiements exceptionnellement autorisés431
- a. Paiements par compensation de dettes connexes431
- b. Paiements autorisés par le juge-commissaire440
- 1) Les paiements pouvant être autorisés dans le cadre des procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire441
- 2) Les paiements pouvant être autorisés dans le cadre de la liquidation judiciaire446
- c. Le paiement des créances alimentaires446
- d. Le paiement de certaines créances salariales448
- B. L'arrêt des poursuites individuelles448
- 1° Le domaine de l'arrêt des poursuites individuelles449
- a. Les poursuites arrêtées450
- 1) Les actions incluses450
- 2) Les procédures d'exécution et de distribution455
- b. Les poursuites autorisées457
- 2° Le régime des poursuites arrêtées463
- § 2. Les restrictions affectant la substance des droits des créanciers465
- A. L'arrêt du cours des intérêts465
- B. L'interdiction des inscriptions467
- C. L'interdiction de l'accroissement et de la mutation de l'assiette des sûretés réelles469
- Chapitre 2
- Les facilités de la procédure collective 475
- Section 1 - La continuation des contrats en cours 476
- § 1. Le domaine de la continuation des contrats en cours477
- A. Les procédures concernées477
- B. Les contrats auxquels s'applique le régime général de continuation478
- 1° Notion de contrat en cours478
- 2° Contrats conclus en considération de la personne481
- § 2. Le régime des contrats en cours484
- A. Le principe de continuation des contrats en cours485
- B. L'exercice de l'option487
- 1° Les modalités d'exercice de l'option487
- 2° Les conséquences de l'exercice de l'option489
- a. L'option pour la continuation du contrat489
- b. L'option pour la résiliation du contrat492
- § 3. Les régimes spécifiques applicables à certains contrats494
- A. Les régimes spécifiques renforçant la procédure collective495
- 1° Le régime spécifique au bail d'immeuble utilisé pour l'activité de l'entreprise495
- a. Régime particulier de résiliation496
- 1) Résiliation en cas de sauvegarde ou de redressement497
- 2) Résiliation en cas de liquidation judiciaire500
- b. Autres aspects du régime particulier du contrat de bail502
- 2° Le régime spécifique au contrat de travail503
- B. Les régimes spécifiques relativisant la procédure collective507
- 1° Les contrats d'édition et de production audiovisuelle507
- 2° Les contrats en matière financière509
- 3° Le contrat de fiducie et la convention de mise à disposition509
- Section 2 - La protection sélective des créances postérieures 512
- § 1. Le domaine d'application des articles L. 622-17 et L. 641-13 du Code de commerce515
- A. Une créance née régulièrement515
- B. Le critère chronologique516
- C. Line créance respectant un critère téléologique518
- § 2. Les avantages résultant des articles L. 622-17 et L. 641-13 du Code de commerce524
- A. Le paiement à l'échéance524
- B. Le privilège de procédure526
- 1° Le rang attribué par le privilège527
- a. Le rang attribué par le privilège en sauvegarde et en redressement528
- 1) L'ordre externe.528
- 2) L'ordre interne530
- b. Le rang attribué par le privilège en liquidation judiciaire532
- c. La mise en échec du classement537
- d. La garantie de l'AGS539
- 2° La conservation du privilège de procédure : l'information sur les créances postérieures impayées543
- a. Les modalités de l'information544
- b. Effets de l'information546
- Chapitre 3
- Le patrimoine du débiteur en procédure collective 549
- Section 1 - La détermination du passif du débiteur en procédure collective 550
- Sous-section 1 - Le passif général 550
- § 1. La déclaration des créances et des sûretés552
- A. Domaine de l'obligation de déclaration553
- 1° Principe553
- a. Énoncé du principe553
- b. Applications559
- 2° Les exceptions562
- B. Modalités de la déclaration de créance567
- 1° L'auteur de la déclaration567
- a. La déclaration par le créancier567
- b. La déclaration par le débiteur pour le compte du créancier570
- c. La déclaration par l'agent des sûretés572
- 2° Le destinataire de la déclaration572
- 3° Le délai pour déclarer573
- 4° Le contenu de la déclaration579
- C. Sanction du défaut de déclaration583
- 1° L'inopposabilité de la créance ou de la sûreté à la procédure583
- a. Conséquences du défaut de déclaration de la créance ou de la sûreté à l'égard du débiteur et de la procédure584
- b. Conséquences du défaut de déclaration de la créance sur la garantie consentie par un tiers588
- 2° Le relevé de forclusion591
- § 2. La vérification des créances596
- § 3. La décision du juge-commissaire599
- Sous-section 2 - Le passif salarial 610
- § 1. L'établissement des relevés de créances salariales610
- A. Procédure d'établissement des relevés de créances salariales611
- B. L'information des salariés612
- § 2. Les contestations relatives aux créances salariales613
- Sous-section 3 - Les dispositions spécifiques à certaines procédures 615
- § 1. Les dispositions spécifiques à la sauvegarde accélérée616
- § 2. Les dispositions spécifiques à la procédure de traitement de sortie de crise616
- Section 2 - La détermination de l'actif du débiteur en procédure collective 617
- Sous-section 1 - L'actif appréhendable 618
- § 1. La consistance d'actif appréhendable619
- A. Les situations de concours620
- 1° L'indivision620
- 2° La communauté entre époux623
- a. L'appréhension des biens communs624
- b. Sort des biens propres de l'époux in bonis628
- 3° Le démembrement de propriété630
- B. La délimitation du patrimoine soumis à la procédure collective630
- § 2. L'identification de l'actif appréhendable632
- Sous-section 2 - L'actif reconstitué 637
- § 1. Les nullités de la période suspecte638
- A. La délimitation de la période suspecte640
- 1° La détermination de la date réelle de cessation des paiements640
- 2° Les butoirs641
- 3° Les modalités procédurales du report de la date de cessation des paiements644
- B. Les cas de nullité647
- 1° Les nullités de droit de la période suspecte647
- a. Contrepartie absente ou insuffisante648
- b. Paiements suspects649
- c. Création d'une préférence injustifiée653
- 1) Nullité d'un dépôt ou d'une consignation de sommes effectué en application de l'article 2350 du Code civil653
- 2) Nullité d'une sûreté réelle conventionnelle ou d'un droit de rétention conventionnel consenti pour une dette antérieure654
- 3) Nullité des inscriptions conservatoires657
- d. Les protections usurpées657
- e. Les options659
- 2° Les nullités facultatives de la période suspecte659
- a. Les nullités de l'article L. 632-1, II du Code de commerce659
- b. Les nullités de l'article L. 632-2 660
- 1) Les actes660
- 2) La connaissance de l'état de cessation des paiements662
- 3° L'exception posée à l'article L. 632-3 du Code de commerce663
- C. L'exercice de l'action en nullité et ses effets664
- § 2. Les autres actions destinées à augmenter l'actif de la procédure collective667
- A. L'action paulienne668
- B. Les actions en responsabilité civile exercées contre les tiers671
- 1° L'action en responsabilité pour soutien abusif672
- 2° La protection octroyée par l'article L. 650-1 du Code de commerce674
- a. Le principe de non-responsabilité676
- 1) Champ d'application du principe de non-responsabilité676
- 2) Portée du principe de non-responsabilité678
- 3) Mise en oeuvre du principe de non-responsabilité680
- b. Les exceptions au principe de non-responsabilité681
- 1) La définition des exceptions682
- 2) Les effets des exceptions686
- Sous-section 3 - L'actif appartenant à des tiers 687
- § 1. L'action en revendication688
- A. Les hypothèses d'exercice de l'action en revendication689
- 1° L'hypothèse générale690
- 2° La revendication permise par une clause de réserve de propriété692
- 3° L'action en reprise de l'entrepreneur individuel695
- B. Les modalités de la revendication696
- C. Les biens susceptibles de revendication700
- 1° Les biens incorporés ou transformés700
- 2° Les biens fongibles702
- 3° Les biens disparus704
- D. Les effets de l'action en revendication707
- 1° Les conséquences de l'inaction du propriétaire707
- 2° Conséquences de l'exercice de l'action en revendication709
- § 2. L'action en restitution711
- Titre 3
- Les issues de la procédure collective715
- Sous-Titre 1
- Les plans de sauvegarde et de redressement719
- Chapitre 1
- L'élaboration et l'adoption du plan 721
- Section 1 - Le projet de plan 721
- § 1. Le processus d'élaboration du projet de plan722
- A. L'élaboration du projet de plan pendant la période d'observation722
- B. L'élaboration du projet de plan au cours d'une conciliation725
- § 2. Le contenu du projet de plan726
- Section 2 - La consultation des créanciers 727
- § 1. La consultation individuelle728
- § 2. La consultation d'une collectivité de créanciers732
- A. Le droit antérieur à l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 : les comités de créanciers733
- 1° Domaine des comités de créanciers733
- 2° Constitution et composition des comités734
- 3° Mode d'intervention des comités738
- B. Les classes de parties affectées741
- 1° Le domaine des classes de parties affectées743
- a. Les procédures concernées743
- b. Les entreprises débitrices concernées744
- 2° Le fonctionnement des classes de parties affectées747
- a. Les propositions destinées à l'élaboration du plan747
- b. La composition et la constitution des classes de parties affectées750
- 1) Les parties affectées750
- 2) Les classes constituées755
- c. Les modalités d'adoption du plan par les classes de parties affectées765
- 1) Le vote765
- 2) Les issues du vote767
- 3° Les voies de recours774
- Section 3 - Le jugement statuant sur le plan 777
- § 1. La décision777
- A. Le jugement arrêtant le plan778
- B. Le jugement rejetant le projet de plan781
- § 2. Les recours782
- Chapitre 2
- Le contenu du plan 785
- Section 1 - La réorganisation de l'entreprise 786
- § 1. Les mesures relatives à l'activité de l'entreprise786
- A. Les mesures relatives aux actifs de l'entreprise786
- 1° Les cessions d'actifs787
- 2° L'inaliénabilité de certains biens indispensables788
- B. Le redéploiement des activités791
- § 2. Les mesures relatives au capital social791
- A. Les augmentations de capital subordonnées à l'adoption du plan793
- B. Éviction exceptionnelle des associés dans le cadre d'un plan de redressement795
- § 3. Les mesures relatives aux dirigeants796
- § 4. Les mesures relatives aux statuts de la société débitrice798
- Section 2 - L'apurement du passif 798
- § 1. Les règles générales799
- A. Les délais, remises et conversions de créances en capital acceptés par les créanciers801
- B. Les délais de paiement imposés802
- C. Le sort des garants804
- § 2. Le régime spécifique à certaines créances805
- Section 3 - Le financement du plan 807
- Section 4 - Le traitement de l'emploi 809
- § 1. Le traitement de l'emploi dans le plan de sauvegarde809
- § 2. Le traitement de l'emploi dans le plan de redressement811
- Chapitre 3
- L'exécution du plan 813
- Section 1 - Les modalités d'exécution du plan 813
- § 1. Les personnes concernées par l'exécution du plan813
- A. L'effet obligatoire du plan813
- B. L'opposabilité du plan814
- § 2. Le rôle du commissaire à l'exécution du plan815
- § 3. La durée du plan816
- Section 2 - La modification du plan 817
- Section 3 - La lin de l'exécution du plan 820
- Section 4 - L'inexécution du plan 821
- Sous-titre 2
- La liquidation judiciaire825
- Chapitre 1
- Le maintien provisoire de l'activité 829
- Chapitre 2
- Les opérations de liquidation 831
- Section 1 - La liquidation judiciaire simplifiée 832
- Section 2 - La réalisation de l'actif 835
- Sous-section 1 - La détermination de l'actif réalisable 835
- Sous-section 2 - Les modalités de réalisation de l'actif 842
- § 1. Le plan de cession842
- A. La place du plan de cession844
- B. La préparation du plan de cession846
- 1° Contexte de l'offre846
- a. L'offre dans le contexte d'une mesure de traitement amiable847
- b. L'offre dans le contexte d'une procédure collective848
- 2° Régime de l'offre850
- a. Les modalités de l'offre850
- b. L'auteur de l'offre851
- 1) Les interdictions852
- 2) L'autorisation du tribunal854
- c. L'intangibilité de l'offre855
- C. Les finalités du plan de cession856
- 1° La cession d'une entreprise856
- a. La cession des biens utiles à l'activité858
- b. La cession forcée de contrats860
- 1) La cession des contrats visés à l'article L. 642-7 860
- 2) La transmission des contrats de travail863
- 2° Les contreparties à la cession de l'entreprise864
- D. Le jugement statuant sur le plan de cession866
- 1° Les préalables au jugement866
- 2° Le jugement867
- 3° Les voies de recours contre le jugement868
- E. L'exécution du plan de cession871
- 1° L'exécution du plan par le cessionnaire871
- a. L'exécution par l'auteur de l'offre871
- 1) L'exécution immédiate871
- 2) La location-gérance873
- b. La substitution de cessionnaire874
- 2° L'exécution attendue par le cessionnaire876
- 3° La modification du plan de cession877
- 4° L'inexécution du plan de cession878
- § 2. La cession d'actifs isolés880
- A. Les ventes d'immeubles882
- 1° Les adjudications883
- 2° Vente de gré à gré885
- B. Les ventes de meubles886
- Section 3 - L'apurement du passif 888
- § 1. La déchéance du terme889
- § 2. Le maintien de la discipline collective890
- § 3. Les modalités d'apurement du passif891
- A. Principes de répartition de l'actif891
- B. Exceptions897
- 1° Le rétenteur898
- 2° L'attribution judiciaire de la propriété du bien gagé900
- 3° Le transfert de la charge des sûretés dans le cadre d'un plan de cession902
- Section 4 - Les licenciements 905
- Chapitre 3
- Clôture de la liquidation judiciaire 907
- Section 1 - Les conditions de la clôture 908
- § 1. Le cadre de la clôture909
- § 2. Les causes de la clôture911
- A. La clôture pour extinction du passif911
- B. La clôture pour insuffisance d'actif911
- Section 2 - Les effets de la clôture 912
- § 1. Effets à l'égard du débiteur913
- § 2. Effets à l'égard des organes de la procédure collective et du juge-commissaire914
- § 3. Effets à l'égard des créanciers914
- A. Le principe de non-reprise des poursuites916
- B. Les exceptions au principe de non-reprise des poursuites individuelles920
- 1° Hypothèses de reprise des poursuites920
- a. Hypothèses fondées sur le comportement du débiteur920
- b. Hypothèses visant certaines actions ou certaines créances922
- c. Hypothèse tenant à la procédure ouverte924
- 2° Conséquences de la reprise des poursuites924
- § 4. La reprise de la liquidation judiciaire925
- A. Conditions de la reprise de la liquidation judiciaire925
- B. Effets de la reprise de la liquidation judiciaire926
- Sous-titre 3
- Le rétablissement professionnel927
- Chapitre 1
- Le domaine du rétablissement professionnel 929
- Chapitre 2
- Les conditions procédurales du rétablissement professionnel 931
- Chapitre 3
- Les effets du rétablissement professionnel 933
- Sous-partie 3
- Les responsabilités et les sanctions937
- Chapitre 1
- L'action en responsabilité pour insuffisance d'actif 939
- Section 1 - Conditions de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif 941
- § 1. Domaine de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif941
- A. Un dirigeant ou un entrepreneur individuel dont les patrimoines sont séparés941
- 1° Personnes morales dirigées942
- 2° Dirigeants943
- a. Dirigeants de droit943
- b. Dirigeants de fait948
- B. Exigence d'une liquidation judiciaire951
- § 2. Cas de responsabilité pour insuffisance d'actif951
- A. La faute commise951
- B. Le lien de causalité957
- C. L'insuffisance d'actif958
- Section 2 - Régime procédural 959
- § 1. Compétence959
- § 2. Saisine du tribunal960
- A. Saisines traditionnelles960
- B. Saisine par des contrôleurs961
- C. Prescription962
- § 3. Particularités de l'instance963
- § 4. Frais de justice965
- Section 3 - Résultats de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif 966
- § 1. Répartition des responsabilités entre les dirigeants967
- § 2. Montant et exécution des condamnations968
- § 3. Affectation des sommes versées969
- Chapitre 2
- Sanctions professionnelles 971
- § 1. Règles communes à la faillite personnelle et à l'interdiction de gérer973
- A. Domaine des sanctions professionnelles973
- B. Procédure974
- C. Les condamnations976
- § 2. Règles particulières à la faillite personnelle978
- A. Causes de faillite personnelle978
- B. Effets propres à la faillite personnelle982
- § 3. Règles propres à l'interdiction de gérer.,983
- Chapitre 3
- Sanctions pénales propres aux procédures collectives 985
- § 1. Le délit de banqueroute985
- § 2. Les délits annexes992
- Partie 2
- Le droit des procédures d'insolvabilité internationales993
- Titre 1
- Le droit international privé des procédures d'insolvabilité internationales995
- Chapitre 1
- La compétence juridictionnelle 997
- Chapitre 2
- La compétence législative 1001
- Chapitre 3
- L'effet international de la procédure 1005
- Section 1 - Les effets de la procédure française à l'étranger 1005
- Section 2 - Les effets d'une procédure étrangère en France 1007
- Titre 2
- Le droit européen des procédures d'insolvabilité internationales1009
- Chapitre 1
- Le règlement insolvabilité 1015
- Section 1 - Le champ d'application du règlement insolvabilité 1015
- § 1. La localisation du centre des intérêts principaux du débiteur1016
- § 2. La procédure ouverte1016
- § 3. L'internationalité de la procédure ouverte1020
- Section 2 - La compétence juridictionnelle 1022
- § 1. La juridiction compétente pour ouvrir la procédure1022
- A. La compétence fondée sur la localisation du centre des intérêts principaux1023
- 1° Principe1023
- a. Le rôle du centre des intérêts principaux1023
- b. La détermination du centre des intérêts principaux1025
- 2° Le cas particulier des sociétés appartenant à un groupe1031
- B. La compétence fondée sur la localisation d'un établissement1036
- 1° La notion d'établissement1036
- 2° Les procédures pouvant être ouvertes au lieu de l'établissement1037
- a. La procédure secondaire1037
- 1) L'ouverture de la procédure secondaire1038
- 2) L'articulation des procédures1040
- α) Les obligations de coopération1041
- β) La coordination des procédures1043
- 3) L'évitement de la procédure secondaire1044
- α) La procédure « virtuelle »1044
- β) La suspension provisoire de l'ouverture de la procédure secondaire1047
- b. La procédure territoriale1048
- C. Le contrôle de la compétence1049
- 1° L'obligation de vérification de compétence par la juridiction saisie1050
- 2° La contestation de la compétence1051
- § 2. La compétence en matière d'actions annexes1053
- A. La notion d'action annexe1055
- B. Le régime des actions annexes1058
- Section 3 - La reconnaissance des décisions 1063
- Section 4 - La détermination de la loi applicable 1071
- § 1. Le principe d'application de la loi de la procédure1071
- § 2. Les exceptions à l'application de la loi de la procédure1073
- A. Les règles de compétence dérogatoires1073
- B. Les règles matérielles1075
- 1° La protection des droits réels des tiers1076
- 2° L'information des créanciers étrangers1081
- 3° La production des créances1083
- 4° La localisation des actifs1084
- Chapitre 2
- Les directives relatives aux établissements de crédit et aux entreprises d'assurance 1087
- Section 1 - L'unicité de procédure 1091
- Section 2 - La détermination de la loi applicable 1092
- § 1. L'application de la loi de l'État membre d'origine1092
- § 2. Les exceptions à l'application de la loi de l'État d'origine1093
- A. L'application de la loi d'un autre État membre1093
- B. Les règles matérielles1097
- Index alphabétique1099
-
-
Origine de la notice:
- Electre
-
Indisponible - En traitement

