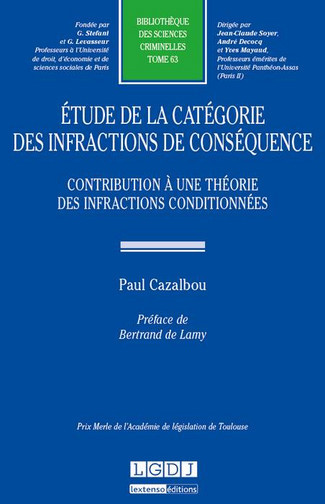Étude de la catégorie des infractions de conséquence
Contribution à une théorie des infractions conditionnées
Paul Cazalbou
LGDJ
lextenso
PréfaceV
Remerciements de l'auteurVII
Liste des principales abréviationsIX
Introduction générale1
Partie I
L'appartenance des infractions de conséquence à la catégorie des infractions conditionnées
Titre I : La communauté structurelle révélée par le rapprochement avec la complicité25
Chapitre 1. La discussion des motifs de « l'autonomisation » des infractions de conséquence27
Section 1. La recherche d'une prescription autonome du recel27
§ 1. Une autonomie discutable dans son principe
28
A. La contradiction avec les justifications politiques de la prescription28
1. L'instauration d'un phénomène d'oubli sélectif29
2. L'instauration d'un problème insoluble de preuve30
B. La contradiction avec l'effet de l'amnistie de l'infraction principale31
1. L'amnistie réelle de l'infraction principale étendue au recel31
2. L'amnistie réelle de l'infraction principale étendue sans justification au recel32
§ 2. Une autonomie pratiquement remise en cause
33
A. L'instauration ponctuelle d'une dépendance des prescriptions33
1. La connexité avec l'infraction principale, motif d'interruption de la prescription33
2. La clandestinité de l'infraction principale, motif de suspension de la prescription34
B. La réticence aux applications extrêmes de l'autonomie des prescriptions35
1. La portée potentiellement démesurée de l'autonomie35
2. L'incertitude quant à l'exploitation jurisprudentielle de l'autonomie36
Section 2. La recherche d'un titre de compétence autonome du recel>38
§ 1. La discussion des hypothèses motivant l'autonomisation
39
A. Le recel en France d'une infraction commise à l'étranger40
1. Un problème originellement marginal40
2. Un problème aujourd'hui résolu41
B. Le recel en France d'une infraction commise à l'étranger par un Français41
1. L'exposé de l'hypothèse problématique41
2. Le constant d'un problème plus pratique que juridique42
§ 2. Une autonomisation pratiquement discutable
43
A. Une autonomisation peu opportune en termes répressifs44
1. Une simple inversion des titres de compétence44
2. Une inversion discutable au regard de l'objectif poursuivi45
B. Une autonomisation incertaine dans sa mise en oeuvre46
1. L'interrogation persistante quant au régime de la nouvelle compétence46
2. La meilleure opérabilité de la complicité internationale47
Conclusion du Chapitre 149
Chapitre 2. Le résultat non concluant de « l'autonomisation » des infractions de conséquence51
Section 1. Un caractère sui generis non avéré51
§ 1. Des infractions conditionnées comparables à la complicité
52
A. La démonstration nécessaire de l'infraction principale52
1. Un degré d'exigence uniforme à l'égard de l'infraction principale52
a) L'existence de l'infraction principale
52
b) La connaissance de l'infraction principale
53
2. L'incidence commune des circonstances affectant l'infraction principale54
a) Les circonstances communément indifférentes au recel et à la complicité
54
b) Les circonstances influant communément sur le recel et la complicité
56
B. L'encadrement de la répression par l'infraction principale57
1. L'autonomie relative de la pénalité de l'infraction de conséquence57
a) L'existence d'une pénalité propre de référence
57
b) L'influence indirecte de la pénalité de l'infraction principale
58
2. La dépendance relative de la complicité dans la pénalité58
a) La liberté offerte par l'Ancien Code pénal
58
b) Les libertés offertes par la complicité dans les autres Codes
59
§ 2. Une technique d'incrimination comparable à celles de la complicité
60
A. L'existence d'incriminations « autonomes » d'actes de complicité61
1. Les incriminations spéciales expresses de la complicité61
a) L'incrimination spéciale de la complicité par abstention
61
b) La prise en compte de nouvelles formes de participation
62
2. Les incriminations spéciales de comportements de complicité63
a) L'incrimination autonome de formes d'aide ou assistance
63
b) L'incrimination spéciale de l'abstention et de la négligence
63
B. L'existence d'incriminations « indépendantes » de la provocation64
1. Des justifications identiques à celles de l'autonomisation du recel64
a) L'assimilation contestée de l'auteur moral à un simple complice
64
b) Les inconvénients pratiques de l'application de la complicité à l'auteur moral
65
2. La possibilité d'une indépendance réelle par rapport à l'infraction principale66
a) Variété des formes de la provocation autonomisée
66
b) Possibilité d'une autonomie réelle de la provocation
66
Section 2. Une distinction par la connexité peu convaincante69
§ 1. Un lien inapte à expliquer la spécificité des infractions de conséquence
69
A. L'inaptitude à décrire le rapport à l'infraction préalable70
1. La connexité, un lien de circonstances et réciproque70
a) Un lien fondé sur des considérations extérieures à l'infraction
70
b) Un lien réciproque
71
2. Le rapport à l'infraction préalable, intrinsèque et unilatéral72
a) Un lien intrinsèque à l'infraction de conséquence
72
b) Un lien à sens unique
72
B. L'incapacité à expliquer le régime des infractions de conséquence73
1. Les implications trop restreintes de la connexité73
2. Le rapport ambigu de la connexité aux effets de l'autonomisation74
a) La connexité, étrangère aux effets de l'autonomisation
74
b) La connexité, mécanisme parasite de l'autonomisation
74
§ 2. Un lien inapte à distinguer les infractions de conséquence de la complicité
75
A. L'incapacité du lien d'indivisibilité à se distinguer76
1. Un lien entre plusieurs infractions confondu avec la connexité76
a) Un cumul imprécis de liens de connexité
76
b) Un lien de nature différente ramenant à la connexité
77
2. Un avatar de la théorie de l'unité de délit dépouillé de toute spécificité78
a) Une théorie éludant le problème de distinction avec la connexité
78
b) Une théorie diluant l'indivisibilité dans d'autres concepts du droit pénal
78
B. L'incapacité du lien d'indivisibilité à rendre compte de la complicité80
1. L'incompatibilité de termes entre indivisibilité et complicité80
2. L'inaptitude de l'indivisibilité à expliquer le régime de l'acte de complicité81
a) Les effets trop restreints de l'indivisibilité
81
b) La mise à l'écart de l'indivisibilité par la jurisprudence
81
Conclusion du Chapitre 285
Conclusion du titre I87
Titre II : La communauté fonctionnelle constatée au sein de la participation criminelle89
Chapitre 1. L'intégration typologique des infractions de conséquence à la participation criminelle91
Section 1. Le lien de causalité, obstacle contournable à l'intégration91
§ 1. L'inaptitude de la causalité à délimiter la participation
92
A. La périmètre restrictif induit par les conceptions strictes de la causalité93
1. La variété des fondements possibles d'une causalité stricte93
2. La réduction commune du champ de la participation criminelle94
a) L'auteur principal, cause stricte de l'infraction
94
b) L'auteur principal, seule cause de l'infraction
95
B. Le périmètre excessif induit par la théorie de l'équivalence des conditions96
1. Les termes excessifs de la théorie de l'équivalence des conditions96
2. La contrariété de l'équivalence des conditions au périmètre de la participation96
a) L'extension de la participation à des comportements classiquement exclus
97
alpha) La dilution de l'aspect matériel de la participation
97
béta) La dilution de l'aspect intellectuel de la participation
97
b) L'exclusion par la causalité de cas de participation avérée
98
alpha) L'aide ou assistance, condition sine qua non douteuse
98
béta) La complicité par acte « non-indispensable », condamnée à disparaître ?
99
§ 2. L'inaptitude de la causalité à expliquer la participation
100
A. L'indifférence de l'infraction principale « abstraite » ou « juridique » à l'acte de complicité102
1. L'autonomie causale de l'infraction principale102
2. La dépendance de l'acte de complicité à l'infraction principale103
B. L'impossible démonstration du rapport de causalité dans l'infraction « concrète »103
1. La discussion de la validité du raisonnement fondé sur la notion d'infraction « concrète »104
a) L'infraction « concrète », notion floue
104
b) L'infraction « concrète », base d'un raisonnement biaisé
104
2. La difficile application de la théorie de l'équivalence des conditions à la complicité105
a) La hiérarchisation des participations, obstacle à leur équivalence causale
105
b) La liberté de l'auteur principal, obstacle au lien de causalité
106
Section 2. La faculté criminogène, critère propice à l'intégration109
§ 1. La vérification de la faculté criminogène des actes de participation criminelle
109
A. La mise à l'écart des caractères variables de la participation criminelle110
1. L'indifférence à la forme matérielle de la mise en relation110
a) La variété matérielle des formes incontestées de participation
111
alpha) La variété matérielle des formes classiques de complicité
111
béta) La variété dans les formes originales de complicité
111
b) L'impossible exclusion d'autres formes matérielles de participation
112
alpha) L'intégration possible de comportements matériellement diffus
112
béta) L'intégration possible de comportements éloignés de l'infraction
113
2. L'indifférence relative au moment de la mise en relation114
a) L'absence de concordance temporelle stricte entre l'infraction et la participation
114
b) L'extension possible de la participation aux actes postérieurs à l'infraction
114
B. L'isolement du caractère invariant de la participation criminelle115
1. L'examen des qualificatifs remarquables de la relation de participation115
a) Participer c'est « faciliter »
115
b) Participer c'est « favoriser »
116
2. La déduction de la faculté criminogène commune des actes de participation117
a) La faculté criminogène : vérifiée par la participation classique
117
b) La faculté criminogène : vérifiant les formes originales de participation
118
§ 2. La précision fonctionnelle induite de la participation criminelle
120
A. La participation criminelle comme instrument de politique criminelle121
1. Instrument de prévention des infractions121
2. Instrument de perfection de la répression123
B. La participation criminelle comme avatar de l'autotrophie de la norme123
1. L'infraction principale comme interdit primaire123
2. Les actes de participation criminelle comme interdits par référence124
a) La dissémination autour de l'infraction principale
124
b) La référence à l'infraction principale
125
Conclusion du Chapitre 1129
Chapitre 2. La distinction juridique des infractions de conséquence dans la participation criminelle131
Section 1. L'inaptitude de la participation criminelle à distinguer juridiquement les infractions de conséquence131
§ 1. Le regroupement de comportements aux régimes juridiques hétérogènes
132
A. Variété des traductions juridiques de la participation criminelle132
1. Le « discours général » sur la participation criminelle133
2. Le « discours spécial » sur la participation criminelle134
B. Hétérogénéité juridique des traductions de la participation criminelle137
1. La participation tendant à la dépendance137
2. La participation tendant à l'autonomie140
§ 2. L'homogénéisation par le droit des comportements de participation
141
A. L'auteur principal réduit au rang de simple participant141
1. La relativisation doctrinale du rôle de l'auteur principal141
2. La relativisation technique du rôle de l'auteur principal142
B. Le participant élevé au rang d'auteur principal143
1. Le participant, auteur d'une infraction autonome143
2. Le participant, auteur d'une infraction dépendante144
Section 2. L'aptitude des infractions de conséquence à se distinguer juridiquement dans la participation criminelle147
§ 1. La distinction non pertinente par l'emprunt de pénalité
147
A. Une pénalité par référence non spécifique à la participation criminelle148
1. Une technique présente en dehors de la participation criminelle148
2. Une technique écartée dans la participation criminelle149
B. Une pénalité par référence non uniforme dans la participation criminelle150
1. L'impossibilité de déterminer a priori la criminalité de l'acte de participation150
a) La criminalité relative des formes de la participation
150
b) La criminalité relative de l'infraction de référence
152
2. La variété subséquente des formes de la pénalité d'emprunt152
a) La mosaïque des techniques de détermination de la pénalité par référence
152
alfa) La variété dans la référence à l'infraction principale153
bêta) La variété dans la référence à la pénalité de l'infraction principale154
b) La liberté d'appréciation finalement laissée au juge
154
§ 2. La distinction pertinente par l'emprunt de criminalité
155
A. Les infractions autonomes ou formelles de la participation criminelle157
1. Le recoupement de la catégorie des infractions formelles par la participation autonome157
a) Les infractions formelles de la participation
157
b) Les infractions obstacles de la participation
158
2. La fonction préventive de la participation assumée par les infractions formelles159
a) L'appréhension précoce de la participation
159
b) L'appréhension de comportements équivoques
160
alfa) La dilution du comportement de participation dans les infractions formelles160
bêta) La nécessité d'un encadrement des infractions formelles de la participation161
B. Les infractions dépendantes ou de résultat de la participation criminelle163
1. Le recoupement de la catégorie des infractions de résultat par la participation conditionné163
a) L'élévation de l'infraction principale au rang de résultat accompli
163
b) L'identification textuelle de l'exigence d'une infraction principale accomplie
164
2. La fonction répressive de la participation assumée par les infractions de résultat165
a) Le report du seuil d'intervention au jour de l'atteinte
165
b) Le recours à des incriminations plus compréhensives
165
Conclusion du Chapitre 2169
Conclusion du titre II171
Conclusion de la partie I173
Partie II
L'application aux infractions de conséquence du régime des infractions conditionnées
Titre I : L'influence de l'infraction principale sur le régime de l'infraction conditionnée177
Chapitre 1. La nécessité d'une infraction principale au sens strict179
Section 1. La mise à l'écart des conceptions minimalistes de l'infraction principale179
§ 1. Le rejet des conceptions minimalistes propres aux infractions conditionnées
180
A. La mise à l'écart de la référence à la simple « figure du délit »181
1. La remise en cause de l'élément matériel de l'infraction181
a) L'altération de l'élément matériel
181
b) L'indifférence à la réalisation effective de l'élément matériel
182
2. La remise en cause de l'élément légal de l'infraction183
a) L'altération de la structure même des incriminations
183
b) La référence à des incriminations latentes
184
B. La remise en cause de l'imputation distincte d'un simple « fait » dénué de sa composante morale185
1. Une théorie assise sur des postulats fragiles185
a) La contradiction supposée de l'emprunt de criminalité aux textes afférents à la complicité
185
alpha) L'exemple du chasseur manipulé185
bêta) La combinaison paradoxale de l'emprunt de criminalité et de l'art. 60 al. 1 ACP186
b) La contradiction supposée de l'emprunt de criminalité avec la jurisprudence
188
alpha) Une jurisprudence inconstante et ambiguë188
bêta) Une jurisprudence motivée par des considérations d'opportunités189
2. Une théorie aboutissant à des conclusions discutables190
a) L'établissement d'une conception stricte de la qualification
190
b) La contradiction générée avec le postulat de l'étude
190
alpha) L'impossibilité de condamner le complice d'un auteur principal dénué d'intention190
bêta) L'impossibilité d'imputer distinctement à l'auteur et au complice un simple « fait »191
§ 2. La mise à l'écart de la théorie de la distinction de l'infraction et du délinquant
192
A. Le caractère artificiel de la distinction de l'infraction et de son auteur193
1. L'exclusion discutable de l'imputabilité du champ de l'infraction193
a) L'apparence d'un simple choix de présentation de l'existant
193
b) L'anéantissement de l'élément moral de l'infraction
195
2. Les artifices techniques au service de l'exclusion de l'imputabilité du champs de l'infraction196
a) L'artifice procédural dissimulant le caractère préalable de l'imputabilité
196
b) L'artifice sémantique dissimulant le caractère préalable de l'imputabilité
197
B. L'orientation de la théorie vers la répression de la seule participation198
1. L'indifférence de l'auteur principal à la théorie198
a) L'éviction de l'auteur principal des développements théoriques sur le délinquant
198
b) L'exclusion de l'auteur principal des bénéfices pratiques de la théorie
199
2. L'incidence remarquable de la théorie sur le sort du participant200
a) Une théorie décisive sur le sort du participant à l'infraction
200
b) Une théorie assise sur un raisonnement en opportunité répressive
200
Section 2. Le report sur une conception stricte de l'infraction principale203
§ 1. La démonstration de l'ensemble des éléments qualifiants
203
A. L'établissement de l'élément matériel de l'infraction principale204
1. L'atténuation de l'élément matériel204
2. La densification de l'élément matériel205
a) La densification par l'exigence d'une qualité personnelle à l'auteur de l'infraction principale
205
b) La densification par l'adjonction de circonstances aggravantes à l'infraction principale
205
alpha) Des circonstances relativement indifférentes à l'infraction conditionnée
205
béta) Des circonstances appréciées en la personne et les actes de l'auteur principal
206
B. L'établissement de l'élément moral de l'infraction principale209
1. L'incidence limitée de l'exigence d'imputabilité de l'« auteur principal »210
2. La compensation de l'exigence d'imputabilité de l'« auteur principal »211
a) La compensation à texte constant, le recours à la théorie de l'auteur « médiat »
211
b) La compensation par incriminations spécifiques, le recours à l'abus de faiblesse
212
§ 2. La nécessité de persistance de l'élément légal
214
A. La neutralisation de l'élément légal par la justification de l'infraction principale214
1. La neutralisation de l'infraction conditionnée par la justification de l'infraction principale214
2. Le rejet du cantonnement « in personam » de l'effet des faits justificatifs216
B. L'abolition de l'élément légal par l'intervention spéciale du législateur217
1. L'indifférence de l'amnistie à l'élément légal de l'infraction217
a) La distinction discutable des effets des amnisties réelles et personnelles
217
alpha) L'absence de justification technique de la distinction opérée
217
béta) La contrariété de la distinction opérée avec les dispositions légales
218
b) Les effets unitaires et strictement procéduraux des amnisties
219
alpha) Les effets strictement procéduraux de l'amnistie
219
béta) La persistance de la culpabilité de l'individu et de son infraction
220
2. La précision de la portée de l'abrogation de la loi d'incrimination de l'infraction principale220
a) La portée certaine de l'abrogation pour les infractions conditionnées à venir
221
b) La précision des effets passés de l'abrogation de l'incrimination principale
221
alpha) Une loi plus douce à l'égard de l'infraction principale et de l'infraction conditionnée
221
bêta) Un obstacle à l'exécution de la peine prononcée pour infraction conditionnée
222
Conclusion du Chapitre 1225
Chapitre 2. Les tempéraments à l'exigence d'une infraction principale227
Section 1. Les tempéraments d'origine procédurale à l'exigence d'une infraction principale228
§ 1. Les tempéraments par l'autonomie procédurale de l'infraction conditionnée
228
A. L'infraction conditionnée, objet de poursuites autonome228
1. L'indifférence à l'absence de poursuite effective de l'infraction principale228
a) L'indifférence à l'obstacle factuel à la poursuite de l'auteur principal
229
b) L'indifférence au défaut d'initiative de l'autorité de poursuite
229
alpha) Le refus d'exercer l'action publique
229
bêta) Le défaut d'une condition nécessaire à l'exercice de l'action publique
230
2. L'indifférence à l'impossibilité de poursuivre l'infraction principale232
a) L'indifférence de principe à l'égard de la prescription de l'infraction principale
233
alpha) L'autonomie dissimulée de la prescription des infractions conditionnées antérieures
233
bêta) L'autonomie de la prescription révélée par les infractions conditionnées postérieures
234
b) L'influence variable des immunités accordées à l'auteur de l'infraction principale
235
alpha) L'indifférence aux « immunités irrecevabilités » de l'infraction principale
235
bêta) La neutralisation par les « immunités irresponsabilités » de l'infraction principale
237
B. L'infraction conditionnée : source autonome de compétence238
1. L'autonomie à l'égard de la compétence juridictionnelle de l'infraction principale238
a) L'indifférence à l'incompétence française à l'égard de l'infraction principale
238
b) La nécessité d'un chef de compétence français à l'égard de l'infraction conditionnée
239
2. L'encadrement de la compétence juridictionnelle à l'égard de l'infraction conditionnée240
§ 2. Les tempéraments procéduraux par la dépendance à l'infraction principale
241
A. La mutualisation discutable des causes d'interruption de la prescription242
1. La valeur discutable des justifications classiques à l'effet commun des actes interruptifs242
a) Le recours erroné au lien de connexité
242
b) Le recours discutable à un effet in rem des actes interruptifs de la prescription
243
alpha) Un recours arbitrairement limité à la complicité243
bêta) L'aptitude douteuse de l'effet in rem à justifier la solution retenue244
2. La remise en cause de l'effet réciproque des actes interruptifs245
B. La localisation justifiée de l'infraction conditionnée au lieu de l'infraction principale246
1. Variété et insuffisance des explications de l'extension de compétence internationale246
a) L'absence de justification technique quant à la colocalisation de la complicité
246
b) Les incertitudes de la justification par les liens d'indivisibilité et de connexité
248
2. L'infraction principale comme fait constitutif localisant de l'infraction conditionnée251
a) Une explication technique applicable à l'ensemble de la catégorie
251
b) Une explication contestée à tort sur la base de la théorie de la condition préalable
252
alpha) L'insuffisance conceptuelle de la condition préalable252
bêta) La portée technique limitée de la condition préalable pénale255
Section 2. Les tempéraments probatoires à l'exigence d'une infraction principale258
§ 1. La démonstration de l'infraction principale selon la loi française
258
A. Le rejet de l'établissement de l'infraction principale par la loi étrangère259
1. Les arguments peu convaincants en faveur du recours à la loi étrangère259
a) Des arguments dépourvus de toute portée décisive
259
b) Les inconvénients clairs du recours à la norme étrangère
261
2. La base doctrinale discutable en faveur du recours à la loi étrangère262
a) L'affirmation de principe de la possibilité d'appliquer la loi étrangère
262
b) L'étroitesse du domaine concret d'application de la loi étrangère
263
B. L'influence résiduelle de l'élément d'extranéité sur l'infraction conditionnée265
1. Le périmètre d'influence limité de l'élément d'extranéité265
a). Une influence circonscrite par l'indifférence classique à l'infraction principale
265
b). Une influence exceptionnellement étendue sur l'ordre du législateur
266
2. Un impact limité par le rôle attribué à l'élément d'extranéité267
a). Une simple condition à la mise en oeuvre de la compétence française
267
b). Un élément de validation des critères de mise en oeuvre de la loi française
268
§ 2. Le recours aux présomptions dans la démonstration de l'infraction principale
271
A. La variété des présomptions admise dans la démonstration de l'infraction principale271
1. L'absence présumée des circonstances exclusives de l'infraction principale271
a). Le renversement de la charge de la preuve des éléments exclusifs de l'infraction
271
b). La discussion du renversement de la charge de la preuve
272
2. La démonstration par présomption des éléments constitutifs de l'infraction principale273
a). L'exigence initiale de démonstration des éléments constitutifs
274
alfa). Une exigence de « double caractérisation »
274
bêta). Le recours à des qualifications principales moins exigeantes
274
b). Le glissement vers une simple « situation infractionnelle »
275
alfa). L'établissement pratique de l'infraction principale par un faisceau d'indices ténu
275
bêta). La ratification législative du glissement vers la « situation infractionnelle »
277
B. La faculté de contestation limitée de l'auteur de l'infraction conditionnée278
1. La contestation difficile d'une infraction commise par un autre278
a) La difficulté factuelle de la contestation de l'infraction principale
279
b) L'obstacle technique à la contestation de l'infraction principale
279
2. L'exploitation difficile de la défense exercée par « l'auteur principal »281
a) La défense de « l'auteur principal » sans incidence sur l'infraction conditionnée
281
alpha) Les moyens de défense indifférents à l'existence de l'infraction conditionnée
281
bêta) Le contournement des moyens de défense exclusifs de l'infraction conditionnée
281
b) Les obstacles procéduraux à l'exploitation de la défense de « l'auteur principal »
282
alpha) L'autorité relative de la chose jugée : obstacle à la prise en compte de la décision antérieure favorable à l'auteur de l'infraction principale
283
bêta) La procédure de révision : instrument incertain de prise en compte de la décision postérieure favorable à l'auteur de l'infraction principale
284
Conclusion du Chapitre 2289
Conclusion du titre 1291
Titre II : L'influence de sa composante propre sur le régime de l'infraction conditionnée293
Chapitre 1. La caractérisation de la composante propre de l'infraction conditionnée295
Section 1. Le caractère compréhensif de l'élément matériel de la mise en relation295
§ 1. La mise en relation imprécise à l'infraction principale
296
A. L'imprécision des formes classiques d'infractions conditionnées296
1. La liberté induite par les définitions floues de l'acte de complicité296
a) Le recours à des modalités « indéfinies » de mise en relation
297
alpha) La remise en cause du caractère positif de la participation
297
bêta) La remise en cause de l'antériorité de la participation
299
b) Le contournement des modalités « définies » de participation
300
alpha) La création d'adminicules spéciaux dans les infractions de presse
300
bêta) La suppression des adminicules dans les infractions en « faire-faire »
301
2. La ratification législative d'une conception jurisprudentielle extensive du recel302
a) Le silence des textes originels à l'égard de l'élément matériel du recel de choses
302
b) La conception extensive de l'élément matériel du recel dans le nouveau Code pénal
304
alpha) Les modalités multiples et alternatives de l'incrimination du recel304
bêta) La confirmation de l'éviction des caractères classiques du recel305
B. L'imprécision par combinaison du blanchiment306
1. Le recours à l'élément matériel indéfini de la complicité306
2. L'application de l'élément matériel de la complicité à une opération de recel307
§ 2. La mise en relation médiate à l'infraction principale
309
A. Les conceptions extensives du produit et de la chose issue de l'infraction309
B. La dilution du produit et de la chose par le mécanisme de la subrogation311
Section 2. Le caractère discriminant de l'élément moral de la mise en relation313
§ 1. La discussion des conceptions variables de la teneur de l'élément intellectuel
315
A. La nécessité d'une connaissance précise de l'infraction principale chez le complice315
1. La nécessité d'une certaine concordance entre infraction projetée et réalisée315
a) Les circonstances indifférentes à la concordance
315
alpha) L'indifférence relative à l'existence d'un accord entre participants315
bêta) L'indifférence au dol spécial de l'infraction principale316
b) La conception retenue de la concordance entre infraction prévue et réalisée
318
alpha) Le rejet des changements radicaux de qualification318
bêta) L'admission d'une discordance limitée318
2. La discussion de la discordance admise entre infraction prévue et réalisé319
a) La critique de l'indifférence aux circonstances aggravantes non prévues
319
b) La critique du recours à un critère de « prévisibilité »
320
B. L'indifférence à la connaissance précise de l'infraction principale chez les participants postérieurs321
1. La teneur variable de la connaissance entre l'établissement et la répression de l'infraction321
a) La connaissance du caractère infractionnel au stade de l'établissement de l'infraction
321
b) La connaissance précise de l'infraction principale au stade de la répression
322
2. La précision de la justification à la variation de teneur de la connaissance322
a) La justification erronée par la norme de pénalité
323
b) La justification possible par la norme de comportement
323
§ 2. Les systèmes de substitution envisageables
324
A. L'inopportunité d'une exigence de connaissance précise de l'infraction325
1. Un système du « tout ou rien » répressif325
2. Un système peu compatible avec les spécificités de l'acte de participation325
B. L'opportunité de généraliser le système du recel et du blanchiment326
1. L'absence d'accroissement notable du champ de la répression326
2. La nécessité de révision de la norme de pénalité de la complicité327
Conclusion du Chapitre 1331
Chapitre 2. Les conséquences du caractère autonome de l'infraction conditionnée333
Section 1. La combinaison avec les mécanismes de rattachement à une infraction333
§ 1. La combinaison avec le mécanisme de la tentative
334
A. L'admission technique de la combinaison334
B. La relativisation pratique de la combinaison335
1. La nécessité classique d'un commencement d'exécution335
2. L'impossibilité pour le complice de réaliser un commencement d'exécution335
§ 2. La combinaison des infractions conditionnées entre elles
337
A. Des combinaisons virtuellement infinies337
B. La possibilité d'éluder les combinaisons de qualifications338
Section 2. La génération de conflits de qualifications340
§ 1. Les conflits d'infractions conditionnées
341
A. La variété des situations de conflit342
B. L'exploitation de la résolution des conflits à fin d'encadrement de la répression342
§ 2. Le conflit avec l'infraction principale
344
A. La remise en cause des arguments classiques défavorables au cumul344
1. Le rejet de la justification par « l'immunité » conférée par l'infraction principale344
2. La justification discutable par le risque d'atteinte au principe ne bis in idem345
B. Le constat d'une solution ne ressortant pas à la catégorie347
1. La distinction proposée des suites nécessaires et contingentes de l'infraction principale347
2. La recherche d'une exigence d'altérité d'auteur dans le texte incriminateur347
Conclusion du Chapitre 2351
Conclusion du titre II353
Conclusion de la partie II355
Conclusion générale357
Bibliographie363
Index alphabétique373
Table des matières377
Ouvrages parus dans la même collection395