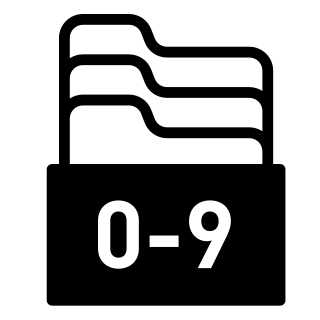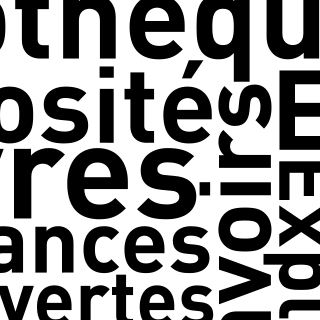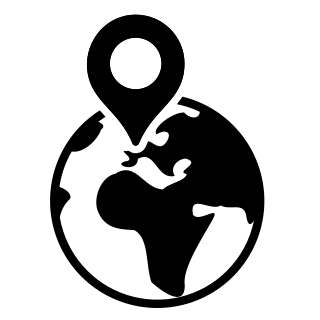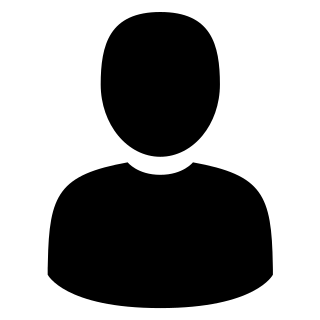par Muracciole, Jules-César
France 3 [prod.] ; Gaumont Télévision [prod.]
1997 -
1 vidéo numérisée (45 min)
-
Consultable à la Bpi
Résumé : Portrait du poète Robert Desnos où l'on évoque son enfance, ses rencontres, ses révoltes, ses passions, ses engagements et enfin, sa mort, le 8 juin 1945, au camp de Terezin, en Tchécoslovaquie. Sur une iconographie très riche, composée de photographies, de dessins, d'images d'archives, d'extraits de films, Jules-César Muracciole fait entendre trois voix, pour raconter Desnos, le lire ou en restituer intensément la présence. L'étudiant tchèque Josef Stuna, jeune infirmier à Terezin, qui avait lu ses poèmes traduits en tchèque, raconte comment, après avoir repéré son nom sur les registres des entrées du camp, il a cherché et retrouvé le poète mourant. Associée à la réalisation de ce film, Marie-Claire Dumas (professeur à l'université de Paris VII), qui s'est consacrée à étudier l'œuvre du poète et à la faire aimer, attire l'attention du spectateur sur "la petite musique entêtante qui se dégage au fur et à mesure de la lecture approfondie des livres de Desnos". Les textes de Desnos dits avec force et simplicité font entendre une voix essentielle.