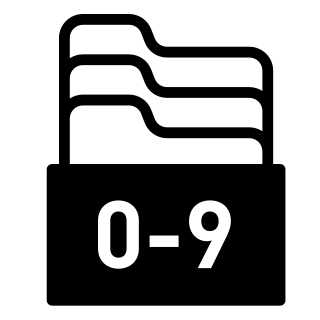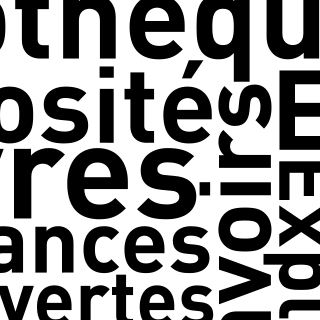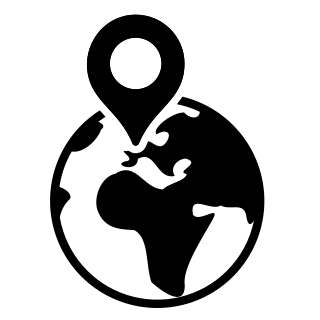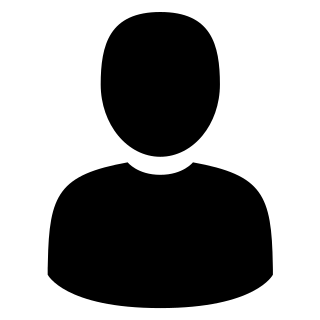par Cozarinsky, Edgardo (1939-2024)
BPI [prod., distrib.] ; Centre Georges Pompidou [prod.]
1992 -
1 vidéo (26 min)
-
Consultable à la Bpi
Résumé : Film réalisé à l'occasion d'une exposition organisée par la Bibliothèque publique d'information sur Borges en 1992. Composé d'une quinzaine de tableaux, où photographies et films d'archives sont accompagnés de la lecture de textes de l'écrivain sur son univers et ses sources d'inspiration.