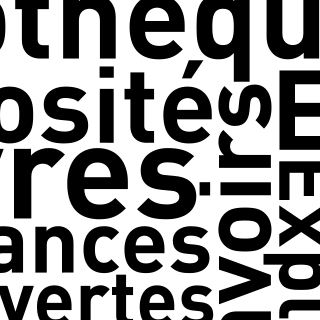par Lebovici, Élisabeth ; Piron, François (1972-....) ; Musée d'art et d'essai (Paris).
Palais de Tokyo ; Fonds Mercator
2023 -
-
Disponible - A partir du 25 août 2025 - 704-99 EXP
Résumé : Parmi ces personnes, des artistes. Parmi ces virus et ces maladies, le VIH/sida, qui a causé l’épidémie la plus meurtrière du dernier siècle, et de celui-ci. Nous vivons aujourd’hui en compagnie d’épidémies qui affectent chacun·e d’entre nous, humains et non-humains. Le livre d’Elisabeth Lebovici, Ce que le sida m’a fait. Art et activisme à la fin du XXe siècle qui inspire l’exposition Exposé·es au Palais de Tokyo et le catalogue qui l’accompagne, s’est efforcé de recoudre ensemble les fragments subjectifs de l’histoire de l’épidémie la plus meurtrière depuis le dernier siècle : des faits, des œuvres, des idées et des émotions qui lient le matériel à l’immatériel. Il questionne comment les pulsations du désir, du manque, de la colère, de la douleur, de la mémoire et de l’archive ont fait histoire. Comment elles ont permis de (re)composer des généalogies interrompues, de fédérer des communautés qui ont produit des formes et des structures, qui agissent encore aujourd’hui, parfois au-delà de leur objet initial. Comment elles ont anticipé certaines questions de genre, de classe et de race, ainsi que l’inconscient de ce qu’on appelle aujourd’hui le validisme. Cette publication questionne ce que l’épidémie de sida fait aux artistes, ce qu’elle a changé dans les consciences, dans la société, dans la création. Le sida, non pas comme un sujet, mais comme une grille de lecture pour reconsidérer un grand nombre de pratiques artistiques exposées à l’épidémie ; la beauté comme recours face aux conséquences politiques et sociales des pandémies qui se superposent. À l’opposé d’une commémoration, cet ouvrage brouille les catégories et les temporalités, et porte un discours au présent, en demandant à des artistes d’interroger depuis aujourd’hui leur histoire et ce qui leur a été transmis. En passant outre la supposée frontière entre activisme et pratique artistique, et en privilégiant au contraire les effets de l’art (sensibles, cathartiques, thérapeutiques, informatifs…), artistes et auteur·ices se rencontrent dans des manières de faire et de parler, d’inclure leurs affects et leurs affinités. Avec les artistes : Les Ami·es du Patchwork des noms, The Bambanani Women’s Group, Bastille, yann beauvais, Black Audio Film Collective, Gregg Bordowitz, Jesse Darling, Moyra Davey, Guillaume Dustan, fierce pussy (Nancy Brooks Brody, Joy Episalla, Zoe Leonard, Carrie Yamaoka), Nan Goldin, Felix Gonzalez-Torres, Hervé Guibert, Barbara Hammer, Derek Jarman, Michel Journiac, Zoe Leonard, audrey liebot, Pascal Lièvre, Santu Mofokeng, Jean-Luc Moulène, Henrik Olesen, Bruno Pelassy, Benoît Piéron, Lili Reynaud Dewar, Jimmy Robert, Régis Samba-Kounzi & Julien Devemy, Marion Scemama, Lionel Soukaz & Stéphane Gérard, Georges Tony Stoll, Philippe Thomas, David Wojnarowicz.

 Les bibliothèques de la ville de Paris
Les bibliothèques de la ville de Paris
 Les bibliothèques universitaires
Les bibliothèques universitaires
 La BnF
La BnF
 L'encyclopédie Wikipédia
L'encyclopédie Wikipédia
 L'Encyclopædia Universalis
L'Encyclopædia Universalis
 La bibliothèque du film
La bibliothèque du film
 La médiathèque de la Philharmonie de Paris
La médiathèque de la Philharmonie de Paris