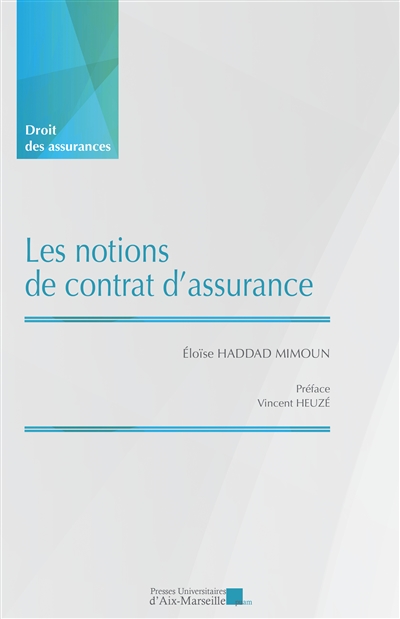Les notions de contrat d'assurance
Éloïse Haddad Mimoun
Vincent Heuzé
Presses Universitaires d'Aix-Marseille
Remerciements9
Préface11
Liste des principales abréviations15
Sommaire17
Introduction19
Première partie
La notion conceptuelle de contrat d'assurance
Titre 1. Un contrat aléatoire de garantie43
Chapitre introductif. L'établissement d'un protocole de qualification45
Section 1. La qualification par la cause du contrat46
I. La thèse de Boyer : la qualification par la cause catégorique46
A. Exposé de la thèse de Boyer46
B. Critique de la thèse de Boyer48
II. La thèse de Mme Rochfeld : la qualification par la cause typique50
Section 2. Les méthodes concurrentes52
I. La qualification par la structure du contrat : la thèse de M. Henry52
A. Exposé de la thèse de M. Henry52
B. Critique de la thèse de M. Henry53
II. La qualification par l'objet du contrat53
A. La théorie de M. Overstake : la qualification par l'objet du contrat, entendu comme l'objet de la prestation principale54
B. La concurrence entre la cause du contrat et l'objet du contrat : exposé de la thèse de Mme Lucas-Puget57
Chapitre 1. Un contrat aléatoire61
Section 1. Les définitions contestables de la cause des contrats aléatoires62
I. Le nouvel article 1108 du code civil et la dilution inévitable du caractère aléatoire du contrat d'assurance62
A. Première interprétation de l'article 1108 du code civil62
B. Seconde interprétation de l'article I 108 du code civil64
II. Contrats aléatoires et diversité des causes66
A. Le contrat envisagé comme une opération de maîtrise du hasard66
B. La distinction entre les contrats économiquement aléatoires et les contrats juridiquement aléatoires68
Section 2. Définition de la cause des contrats aléatoires70
I. La chance de gain ou le risque de perte corrélatifs70
A. Une cause complexe70
B. La notion d'équivalence dans les contrats aléatoires73
1. Conditions d'appréciation de l'équivalence73
a. Analyse de l'ancien article 1104 du code civil73
b. La jurisprudence très contestable en matière d'assurances-vie74
2. Le prix de l'équivalence76
II. L'épuisement de la cause en seulement deux types78
A. Requalification ou disqualification des contrats aléatoires79
1. Disqualification contractuelle79
a. La rente viagère79
b. Le bail à nourriture80
c. La transaction81
2. Requalification contractuelle81
a. La clause de tontine ou clause d'accroissement82
b. La cession de droits litigieux83
c. La vente d'un bien grevé d'un usufruit ou d'un droit d'usage et d'habitation83
B. La chance de gain ou le risque de perte corrélatifs, cause typique nécessaire et suffisante84
1. La distinction entre le type et les sous-types84
2. La distinction entre les contrats de spéculation et les contrats de garantie86
Conclusion87
Chapitre 2. La garantie, finalité socio-économique du contrat89
Section 1. Les éléments constitutifs de la garantie, cause de l'engagement du souscripteur91
I. Difficultés pour associer la garantie à la notion de risque92
II. ta garantie entendue comme l'intérêt d'assurance94
A. L'assiette de l'indemnité94
B. L'imputation de l'indemnité : l'intérêt d'assurance96
Section 2. La fonction commune à tous les contrats de garantie : la recherche d'une indemnisation100
I. Les critères classiques de distinction entre le principe indemnitaire et le caractère forfaitaire100
A. Distinction portant sur la fonction des principes101
B. Distinction portant sur la (onction de l'indemnité101
II. Réfutation de la distinction105
A. Le caractère indemnitaire de tous les types d'assurance105
B. Les conditions de la mise en oeuvre du « régime indemnitaire »110
1. Surassurance, assurances multiples cumulatives, sous-assurance110
2. Le recours subrogatoire de l'assureur contre le tiers responsable112
Conclusion113
Conclusion du Titre I115
Titre 2. Un contrat aléatoire de garantie fondée sur la mutualisation des risques117
Chapitre I. L'insuffisance de la définition du contrat d'assurance comme contrat aléatoire de garantie119
Section I. Les difficultés pour définir la cause de l'engagement de l'assureur119
I. La nécessité de spécifier le contenu de la cause de l'obligation de l'assureur120
A. L'identité d'objet entre les contrats aléatoires de garantie et les contrats aléatoires de spéculation120
B. L'exemple des contrats financiers122
I. Description synthétique des contrats financiers124
a. Les contrats à terme ferme124
b. Les contrats optionnels125
c. Les contrats d'échange125
d. Les dérivés de crédit126
2. Les qualifications envisageables127
a. Exclusion de la qualification comme contrats de vente127
b. Refus de la qualification comme contrats d'assurance129
II. Les obstacles à l'intégration de la notion de garantie dans la cause de l'engagement de l'assureur133
A. La prestation caractéristique et la qualification134
B. La nécessité d'élargir le cadre de la cause pour y inclure la fourniture d'une garantie135
1. La subjectivisation de la cause objective136
2. Les problèmes soulevés par la réforme du droit des obligations137
Section 2. L'absence de contenu obligationnel propre à la notion de garantie139
I. L'impossibilité d'identifier la garantie à une prestation définie140
A. Le rejet de la définition de la garantie comme cession ou transfert de risque140
1. La garantie définie comme un contrat de transfert d'un risque : la thèse de Mme Hage-Chahine140
2. La garantie définie comme un contrat : de cession d'un risque : la thèse de M. Demont141
B. L'introuvable obligation de couverture144
1. Présentation de la notion d'obligation de couverture144
a. Origines de l'obligation de couverture144
b. Les résistances à l'admission de cette obligation146
2. Le renouvellement contemporain de l'obligation de couverture149
II. L'impossibilité de classer la prestation de garantie selon son objet151
A. L'incidence des distinctions relatives à l'objet de l'obligation sur la définition de la cause typique153
B. L'absence d'obstacle relatif à la distinction des objets entre l'obligation de payer une somme d'argent et l'obligation de faire du point de vue de la qualification155
Conclusion159
Chapitre 2. La mutualisation des risques, critère de qualification du contrat d'assurance161
Section 1. L'a garantie par mutualisation des risques, critère distinctif du contrat d'assurance161
I. La construction du régime du contrat d'assurance161
II. Les dispositions spécifiques du régime du contrat d'assurance163
A. Présentation synthétique de la technique de mutualisation des risques164
B. Les conséquences juridiques de la technique de mutualisation des risques165
Section 2. La technique de mutualisation des risques, fonction économique du contrat d'assurance167
I. La fonction économique du contrat, critère de qualification167
A. Le régime du contrat, miroir des politiques socio-économiques168
B. Les interprétations juridiques d'une réalité socio-économique170
II. La technique d'assurance, fonction économique du contrat d'assurance..172
A. Exclusion du contrat d'assurance des fonctions économiques distinguées par l'échange et la coopération174
1. Rejet de la théorie du contrat d'échange174
2. Rejet de la théorie du contrat de coopération175
a. Présentation du fondement théorique du contrat de coopération : l'analyse institutionnelle175
b. Limites de l'analyse institutionnelle178
B. Admission du contrat d'assurance dans la catégorie des contrats aléatoires socialement et économiquement utiles182
1. L'utilité des contrats aléatoires subordonnée à la finalité de garantie183
2. La finalité de garantie des contrats d'assurance distinguée par le recours à la mutualisation des risques : la distinction avec les contrats de maintenance184
Conclusion186
Conclusion du Titre 2187
Conclusion de la Première partie189
Seconde partie
Les notions fonctionnelles de contrat d'assurance
Titre 1. Contrat d'assurance et contrats de pari195
Chapitre I. La présentation des techniques de financement de la garantie distinctes de la mutualisation des risques197
Section I. Le recours à la solidarité199
I. Les manifestations de la solidarité199
II. L'exemple des clauses dites « cal nat »200
Section 2. Les techniques financières alternatives202
1. La garantie des risques par le recours à la titrisation203
A. Présentation de la titrisation203
B. Traduction juridique de la technique de garantie par titrisation205
II. La garantie par le recours à la segmentation, au détriment de la mutualisation207
A. La mise en réserve des capitaux207
1. La garantie des risques nouveaux : l'exemple des contrats d'assurance spatiale208
2. La garantie des risques techniquement et juridiquement problématiques : l'exemple de l'assurance construction208
B. L'hypersegmcntation211
Conclusion212
Chapitre 2. La qualification des contrats reposant sur des techniques alternatives de garantie215
Section 1. La qualification conceptuelle des contrats reposant sur des techniques alternatives de garantie216
I. Le refus de la qualification de contrats pour les mécanismes fondés sur la solidarité216
II. L'identification des opérations reposant sur des techniques alternatives de financement de la garantie comme des contrats de pari217
A. La cause du pari218
B. La qualification conceptuelle des contrats de garantie reposant sur des techniques alternatives219
1. La qualification des contrats financés par la titrisation220
2. La qualification des contrats financés par la technique de segmentation223
Section 2. La qualification fonctionnelle des contrats reposant sur des techniques alternatives de garantie224
I. Le régime du pari, un régime inadéquat224
A. L'inapplicabilité de l'exception de jeu aux contrats aléatoires socialement utiles224
B. Utilité sociale et contrôle étatique226
II. La pertinence de la qualification fonctionnelle de contrat d'assurance228
A. Des contrats de pari socialement utiles grâce à un contrôle sectoriel étendu228
B. La pertinence du régime prévu au livre Ier du code des assurances230
Conclusion232
Conclusion du Titre 1233
Titre 2. Contrat d'assurance et contrats commutatifs d'épargne235
Chapitre 1. L'apparition de contrats d'assurance-vie commutatifs à finalité d'épargne237
Section 1. La distinction entre les contrats de capitalisation et les contrats d'assurance-vie238
I. La distinction des régimes applicables238
A. Les dispositions communes238
B. Les dispositions propres aux contrats d'assurance-vie239
II. La confusion entre les contrats de capitalisation et les contrats d'assurance-vie241
A. Le caractère aléatoire des contrats d'assurance-vie classiques241
1. L'assurance temporaire en cas de décès242
2. L'assurance décès vie entière242
3. L'assurance de rente viagère243
4. L'assurance de capital différé en cas de vie sans remboursement de primes (CDSR)243
B. La difficile caractérisation des contrats d'assurance-vie « modernes »244
1. L'assurance mixte « 10/X »245
2. L'assurance de capital différé en cas de vie avec remboursement des primes (CDAR et CDARM)246
3. L'assurance de capital différé en cas de vie avec remboursement de la réserve mathématique (CDARR)247
4. L'assurance vie/décès à terme fixe248
Section 2. L'évolution du rôle de l'aléa dans la qualification du contrat d'assurance249
I. La qualification forcée des contrats de capitalisation en contrats d'assurance249
A. Étude de la nature des opérations en cause dans les arrêts rendus par la chambre mixte de la Cour de cassation le 23 novembre 2004..250
B. Solution choisie par la Cour de cassation251
II. Restriction des termes du débat252
A. Impossibilité d'appliquer l'essentiel du régime du contrat d'assurance aux contrats de capitalisation252
B. Problème de l'applicabilité des dispositions spécifiques en droit patrimonial de la famille et droit des créanciers aux contrats d'assurance-vie modernes254
Conclusion254
Chapitre 2. La qualification fonctionnelle des contrats d'assurance-vie modernes257
Section 1. Le champ d'application fonctionnel des dispositions dérogatoires257
I. Les choix politiques justifiant le régime dérogatoire en droit fiscal258
II. Les choix politiques justifiant le régime dérogatoire en droit patrimonial de la famille260
A. Les choix politiques justifiant le régime dérogatoire en droit successoral260
1. La volonté de favoriser les opérations de prévoyance260
2. La volonté de favoriser une conception individuelle et patrimoniale de l'héritage263
B. Les choix politiques justifiant le régime dérogatoire en droit matrimonial265
Section 2. Les critères fonctionnels de qualification268
I. L'identification de deux critères268
II. Les exceptions269
A. Problèmes suscités par l'extension du régime de faveur en droit des obligations269
B. Les exceptions prévues par la Cour de cassation271
Conclusion274
Conclusion du Titre 2275
Conclusion de la Seconde partie277
Conclusion générale279
Bibliographie283
Index299
Table des matières303