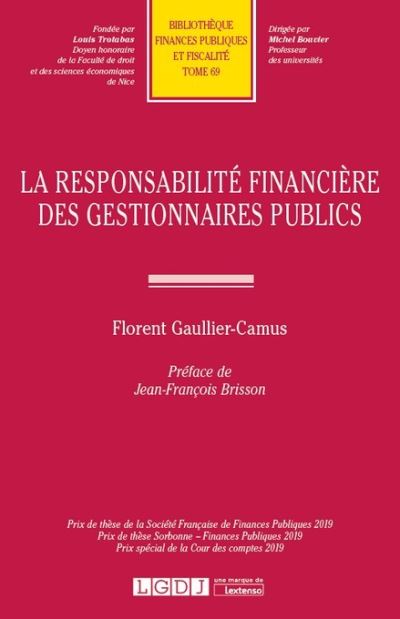La responsabilité financière des gestionnaires publics
Florent Gaullier-Camus
LGDJ
RemerciementsV
PréfaceVII
Principales abréviations utiliséesXI
Introduction1
§ I. État des lieux : l'épuisement du modèle traditionnel de responsabilité financière
3
A. La construction historique d'un modèle de contrôle fondé sur la distinction ordonnateur-comptable3
B. L'épuisement du modèle traditionnel sous l'effet de la logique de performance introduite par la LOLF10
§ II. Projet de recherche : l'introduction d'un concept de responsabilité financière
16
A. Le recours au concept de responsabilité en matière financière17
1. De l'éclatement des figures de la responsabilité17
a) La polysémie de la notion de responsabilité
17
b) L'absence d'unité de la responsabilité juridique
21
2. De la possibilité d'isoler une responsabilité propre aux fonctions financières29
a) Les gestionnaires publics, sujets de la responsabilité financière
30
b) La méconnaissance des règles du droit public financier, substance de la responsabilité financière
39
c) La compétence du juge financier, élément primordial de la responsabilité financière
47
B. L'intérêt d'une recherche autonome sur la responsabilité financière50
1. L'absence d'étude générale relative à la responsabilité financière50
2. Le renouveau du cadre juridique de la gestion publique56
C. La méthode de recherche retenue60
1. Les démarches de la recherche60
2. La problématisation de la recherche62
Partie I
L'unité de la responsabilité financière
Titre I : L'unité des sujets de la responsabilité financière69
Chapitre I. L'interpénétration des fonctions d'ordonnateur et de comptable71
Section 1. La porosité du principe de séparation des ordonnateurs et des comptables72
§ I. La question de la valeur juridique du principe de séparation des ordonnateurs et des comptables
73
A. Une valeur constitutionnelle introuvable73
1. Les critères du PFRLR74
2. Le principe de séparation à l'épreuve des critères du PFRLR77
B. Une valeur supra réglementaire partielle80
1. Les hésitations initiales81
2. Les clarifications actuelles84
§ II. La remise en cause de la valeur structurante du principe de séparation
88
A. Un fondement dépassé du droit public financier88
1. Les justifications du principe de séparation89
2. Les mutations du contexte juridique91
B. Vers une adaptation du principe à la nouvelle gestion publique92
1. L'improbable suppression du principe de séparation93
2. L'immanquable adaptation du principe de séparation95
Section II. La question de la portée de la séparation des ordonnateurs et des comptables97
§ I. Les limites du principe de séparation
97
A. Un principe de séparation non garanti97
1. Un principe de séparation non garanti dans certains organismes publics98
2. Un principe de séparation non garanti pour certaines opérations financières100
B. Un principe de séparation non respecté : le cas particulier de la gestion de fait103
1. Le diagnostic de la gestion de fait104
2. Les conséquences de la gestion de fait107
§ II. Les aménagements du principe de séparation
109
A. Les aménagements éventuels109
1. Les régies d'avances et de recettes110
2. Les services mutualisés112
3. Le compte financier unique et l'agence comptable114
B. Les aménagements permanents116
1. Les paiements réalisés sans ordonnancement ou avant service fait117
2. La réquisition du comptable public119
Chapitre II. La collaboration des ordonnateurs et des comptables123
Section I. L'évolution des missions de l'ordonnateur et du comptable123
§ I. La modernisation du rôle de l'ordonnateur et du comptable
124
A. La redéfinition des acteurs de la gestion publique124
1. Des statuts actualisés124
a) Le statut du comptable
124
b) Le statut de l'ordonnateur
127
2. Des fonctions redistribuées128
a) L'« éclatement » des fonctions d'ordonnateur
128
b) Le resserrement des fonctions du comptable
132
B. La redéfinition des missions des acteurs de la gestion publique135
1. Des missions traditionnelles ajustées à la nouvelle gestion publique135
2. Des missions nouvelles imposées par la nouvelle gestion publique : des fonctions comptables partagées137
a) Le partage dans la tenue des comptabilités publiques
137
b) Le partage dans le respect de l'objectif de qualité comptable
139
§ II. La rationalisation des procédures de la chaîne d'exécution financière
141
A. L'automatisation de la chaîne d'exécution financière141
1. L'informatisation de l'information141
2. L'informatisation des processus143
B. La suppression de certaines opérations de l'exécution financière143
1. L'inutilité de certains contrôles a priori143
2. L'obsolescence de la phase d'ordonnancement144
Section II. Le renouveau des contrôles non juridictionnels de l'exécution financière145
§ I. Le déplacement des moyens de contrôle du processus financier
146
A. Le déploiement des contrôles internes du processus financier147
1. Le contrôle interne budgétaire et comptable149
2. L'audit interne budgétaire et comptable151
B. La généralisation des contrôles a posteriori du processus financier152
1. Le perfectionnement du contrôle de la gestion152
2. Vers une certification de tous les comptes publics156
§ II. Le développement des contrôles comptables sélectifs
162
A. La distinction des contrôles sélectifs164
1. Une distinction initialement justifiée par l'insuffisance des contrôles internes164
2. Vers un contrôle sélectif unique : le contrôle partenarial167
B. La prise en compte des contrôles sélectifs par le juge financier168
1. Une appréhension actuelle insuffisante169
2. Vers une appréhension conforme à la philosophe de la gestion publique174
Conclusion Titre I177
Titre II : L'unité du juge de la responsabilité financière179
Chapitre I. Le juge financier, juge de plein exercice de la responsabilité financière181
Section I. La subjectivisation du contentieux financier181
§ I. La rénovation des procédures dans le cadre d'un véritable procès financier
183
A. Les exigences du procès équitable et le contentieux financier184
1. La transformation des règles de procédures juridictionnelles devant le juge financier185
2. L'émergence d'une véritable procédure contentieuse devant le juge financier189
B. L'audience publique, l'oralité des débats et leur influence sur le contentieux financier191
1. L'audience publique, l'oralité et la place du gestionnaire public dans le procès financier192
2. L'audience publique, l'oralité et la remise en cause du caractère objectif d'une partie du contentieux financier193
§ II. La généralisation de certaines notions dans le contentieux financier
194
A. La notion de manquement194
B. La notion de préjudice197
C. La notion de circonstance de l'espèce199
Section II. Le juge financier, juge des gestionnaires publics201
§ I. Le juge du comportement des gestionnaires publics dans les conditions de mise en jeu de la responsabilité
202
A. Le juge financier, juge du comportement des justiciables de la CDBF202
1. L'appréciation de l'intentionnalité d'une infraction, ou imputabilité morale202
2. L'appréciation de l'attribution individuelle de l'infraction, ou imputabilité matérielle204
B. Le juge financier, juge du comportement des comptables205
1. L'influence de l'adage selon lequel « le juge des comptes juges les comptes et non les comptables »207
2. Vers un élargissement de l'office du juge des comptes209
§ II. Le juge de tous les gestionnaires publics
211
A. La remise en cause de l'injusticiabilité de certains comptables publics secondaires211
1. La question des comptables secondaires non subordonnés212
2. La question des comptables secondaires subordonnés213
B. La remise en cause de l'injusticiabilité de certains ordonnateurs214
1. L'injusticiabilité des ministres et des élus locaux, un principe intenable215
a) Un principe dépassé par les exigences de la nouvelle gestion publique
216
b) Un principe aux assises juridiques contestables et surmontables
218
2. Vers la justiciabilité des ministres et des élus locaux221
a) La justiciabilité des gestionnaires publics en droit comparé
222
b) La question de la justiciabilité de tous les gestionnaires publics en droit français
223
Chapitre II. Le juge financier, juge unique de la responsabilité financière225
Section I. Le juge financier, seul compétent pour mettre en jeu la responsabilité financière225
§ I. Le rôle premier du juge financier dans le processus de mise en jeu de la responsabilité financière
226
A. Le rôle du juge financier dans la programmation des contrôles226
B. Le rôle du juge financier quant aux charges retenues227
1. La sélection des charges227
2. L'appréciation des charges230
§ II. La fin du triple dualisme de la responsabilité financière
233
A. La réorganisation des juridictions financières233
B. La refonte des régimes de responsabilité financière236
C. La question du rôle du ministre dans la mise en jeu de la responsabilité financière237
1. La fin de l'avis du ministre dans la procédure de la CDBF237
2. Vers la fin du rôle du ministre dans la mise en jeu de la responsabilité du comptable238
Section II. Le juge financier, seul compétent pour apprécier la responsabilité financière240
§ I. L'appréciation par le juge financier des causes exonératoires de responsabilité
240
A. L'appréciation de la force majeure par le juge financier241
B. Vers la fin du rôle du ministre dans la décharge de responsabilité243
§ II. L'appréciation par le juge financier des causes limitatives de responsabilité
244
A. La prise en compte des circonstances par le juge financier245
1. La prise en compte actuelle des circonstances par le juge financier245
2. La prise en compte perfectible des circonstances par le juge des comptes250
B. Vers la fin du rôle du ministre dans l'appréciation finale des responsabilités252
1. Le rôle du ministre désormais injustifié252
2. La fin de la remise gracieuse254
Conclusion Titre II257
Conclusion partie I259
Partie II
L'autonomie de la responsabilité financière
Titre I : L'autonomie des éléments de la responsabilité financière263
Chapitre I. La faute objective, fondement de la responsabilité financière265
Section I. L'émergence généralisée de la notion de faute objective comme fondement de la responsabilité financière266
§ I. L'existence latente de la faute objective au sein de la responsabilité financière
266
A. L'existence expresse et résiduelle de la faute dans certaines dispositions légales267
1. La présence anecdotique de la faute dans le cadre de la responsabilité du comptable public267
2. La délicate question de la faute dans les infractions sanctionnées par la CDBF270
B. L'existence implicite et générale de la faute dans le mécanisme de la responsabilité financière272
1. La faute de gestion comme élément ontologique à l'existence de la CDBF272
2. La faute du poste comptable comme fondement véritable à la responsabilité personnelle et pécuniaire273
§ II. L'existence optative de la faute objective au sein de la responsabilité financière
276
A. Rééquilibrer le système de la responsabilité financière276
1. Vers une symétrie partielle des responsabilités277
2. Vers un partage des responsabilités278
B. Simplifier l'organisation de la responsabilité financière279
1. Vers la condamnation définitive de la remise gracieuse279
2. Vers la condamnation définitive de la dualité des juridictions financières280
Section II. L'harmonisation des infractions financières autour de la faute objective281
§ I. Des infractions mieux adaptées aux différentes gestionnaires publics
282
A. Des infractions précisées au regard de la nature des fonctions282
1. Des infractions recentrées sur le coeur du métier comptable282
2. Des infractions prenant en compte le rôle de l'ordonnateur dans la chaîne d'exécution et d'information financière285
B. Des infractions personnalisées au regard de l'implication des différents gestionnaires286
1. La prise en compte de la réalité des postes comptables287
2. La prise en compte de l'éclatement des fonctions d'ordonnateur289
§ II. Des infractions redéfinies en fonction de la gestion publique moderne
290
A. La suppression de certaines infractions purement formelles290
B. La création d'infractions dirigées vers les procédures pour certaines opérations financières293
Chapitre II. Le préjudice financier, élément central de la responsabilité financière295
Section I. La question de l'identification du préjudice en droit public financier295
§ I. Les contours du préjudice en droit public financier
296
A. L'existence d'un lien de causalité entre le manquement du gestionnaire et un dommage296
B. L'existence du préjudice trouvant son origine dans le dommage299
§ II. Les différents types de préjudice en droit public financier
301
A. Le préjudice dans le contentieux de la CDBF301
1. L'appréciation restrictive du préjudice dans le contentieux de la CDBF302
2. Critique de l'appréciation restrictive du préjudice dans le contentieux de la CDBF304
B. Le préjudice dans le contentieux des juridictions des comptes305
1. L'appréciation souple d'un préjudice financier dans le contentieux des juridictions des comptes306
2. Essai d'une classification des différentes situations de préjudice financier307
a) Le manquant en monnaie ou en valeurs
309
b) Les recettes
309
c) Les dépenses
311
i. Les décaissements impossibles
312
ii. Les décaissements possibles mais non souhaités, ou non souhaités de manière suffisamment certaine
313
Section II. La question des conséquences du préjudice en droit public financier316
§ I. La place actuelle du préjudice au sein de la responsabilité financière
316
A. La place du préjudice dans le contentieux de la CDBF316
1. La place du préjudice prévue par les textes316
2. La place du préjudice envisagée par la jurisprudence318
B. La place du préjudice dans le contentieux des juridictions des comptes319
1. Le préjudice financier, déterminant théorique du niveau de responsabilité des comptables320
2. La remise en cause de la place du préjudice financier par les mécanismes régulateurs de la responsabilité comptable321
a) Les situations paradoxales dans lesquelles le comptable sera plus sanctionné en l'absence de préjudice
321
b) Le calcul juridictionnel du préjudice financier, de la simplicité apparente à l'incongruité flagrante
323
c) Le calcul non juridictionnel du laissé à charge final, ou l'inutilité de la place actuelle du préjudice financier
326
§ II. Vers un double glissement du préjudice au sein de la responsabilité financière
327
A. Le glissement du préjudice vers le préjudice financier327
B. Le glissement de la centralité du préjudice financier329
Conclusion Titre I331
Titre II : L'autonomie des fonctions de la responsabilité financière333
Chapitre I. La réparation financière335
Section 1. Le rétablissement de l'ordre public financier335
§ I. Le particularisme de la notion d'ordre public financier
336
A. La signification incertaine de la notion d'ordre public financier336
1. Ordre public financier et police administrative337
2. Ordre public financier et règles procédurables s'imposant au juge339
3. Ordre public financier et règles du droit public financier342
B. Essai d'une définition de la notion d'ordre public financier342
§ II. L'ordre public financier et la responsabilité financière
343
A. L'ordre public financier comme élément justifiant la responsabilité financière343
1. Une justification explicite dans la jurisprudence rendue en matière de responsabilité comptable344
2. Une justification évoquée dans les travaux non juridictionnels de la CDBF345
B. La responsabilité financière comme moyen de rétablissement de l'ordre public financier346
1. Le rétablissement de l'ordre public financier par la mise en lumière des situations irrégulières347
2. Le rétablissement de l'ordre public financier par la stigmatisation d'une gestion irrégulière348
Section II. L'organisation de la réparation financière349
§ I. La répartition générale de la réparation financière
349
A. La répartition actuelle de la réparation financière349
1. Une réparation financière pesant essentiellement sur le comptable public349
2. Une réparation financière pesant précisément sur un seul comptable351
B. Repenser la répartition de la réparation financière352
1. Vers une réparation conjointement répartie entre les gestionnaires publics352
2. L'impossibilité d'envisager une réparation solidairement répartie entre les gestionnaires publics353
§ II. La répartition finale de la réparation financière
354
A. La répartition actuelle du laissé à charge final354
1. Une réparation entièrement assumée par les gestionnaires publics pour la responsabilité engagée devant la CDBF354
2. Une réparation partagée entre comptable, organisme public et assureur pour la responsabilité engagée devant le juge des comptes357
a) L'hypothèse des amendes prononcées par le juge des comptes
357
b) L'hypothèse du débet
358
c) L'hypothèse de la somme non-rémissible
359
B. Repenser la répartition du laissé à charge final360
1. La somme comme unique conséquence de la responsabilité financière360
2. L'assurabilité limitée de la somme prononcée par le juge361
Chapitre II. La répression financière363
Section I. L'étendue de la répression dans le mécanisme de responsabilité financière363
§ I. La fonction répressive de la responsabilité financière dans son ensemble
364
A. Une fonction répressive évidente en matière d'amendes364
1. La fonction répressive de la responsabilité financière dans le prononcé des amendes CDBF364
2. La fonction répressive de la responsabilité financière dans le prononcé des amendes du juge des comptes366
a) L'amende pour retard dans la production des comptes
366
b) L'amende pour gestion de fait
369
B. Une fonction répressive incidente en matière de jugement des comptes370
1. L'hypothèse de la somme non-rémissible370
2. L'hypothèse du débet372
3. L'hypothèse de la procédure de gestion de fait374
§ II. La portée timorée de la fonction répressive au sein de la responsabilité financière
376
A. Une répression financière limitée dans la pratique376
1. Une fonction répressive limitée par la faible activité juridictionnelle de la CDBF376
2. Une fonction répressive limitée par l'organisation actuelle de la responsabilité comptable379
B. Vers une répression financière assumée380
1. Officialiser la double fonction réparatrice et répressive de la responsabilité financière381
2. Mettre en place une répression intelligente et empreinte d'exemplarité382
Section II. Le particularisme de la répression financière384
§ I. La qualification de la répression financière
384
A. Des classifications traditionnelles inappropriées384
1. Répression financière et répression disciplinaire386
2. Répression financière et répression administrative391
3. Répression financière et répression pénale393
B. Vers une qualification autonome de la répression financière397
1. Les éléments propres à la répression financière398
a) La protection de l'ordre public financier
398
b) L'évidence du juge financier
398
2. Vers l'admission d'une véritable notion de répression financière399
§ II. La détermination de la répression financière
399
A. Une détermination actuelle disparate400
1. Une répression CDBF basée sur un minimum légal et le salaire annuel du gestionnaire400
2. Une répression comptable basée essentiellement sur le cautionnement402
B. Vers une détermination de la répression financière repensée et harmonisée405
1. Une détermination basée sur des principes communs405
2. Une détermination adaptée aux différentes situations408
a) Une détermination adaptée en fonction des gestionnaires
408
b) Une détermination adaptée en fonction des infractions
408
Conclusion Titre II411
Conclusion partie II413
Conclusion générale415
Bibliographie421
Table de jurisprudence447
Index469